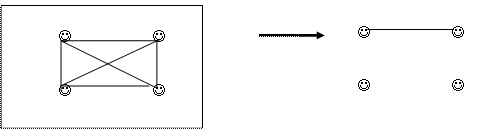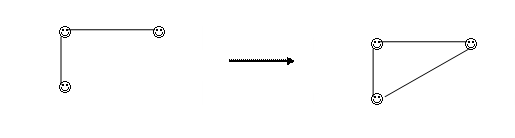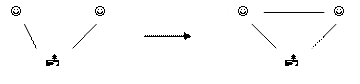Qu’est-ce qu’une relation sociale ? Un ensemble de médiations dyadiques
Michel Grossetti, CNRS et Université de Toulouse[1]
Resumen
Los analistas de redes han desarrollado sofisticados métodos de recogida de información y de análisis de las estructuras de relaciones, pero raramente se han interesado en la definición de las relaciones en ellas mismas. El objetivo de este artículo es proponer un marco teórico que permita definir las relaciones interpersonales y precisar su lugar dentro del conjunto de formas sociales. La reflexión está basada en un estudio empírico sobre las redes personales realizado en el sur de Francia.
Palabras clave: mediación, relación, encaste, desacoplamiento.
Résumé
Les analystes de réseaux ont développé des méthodes sophistiquées de collecte d’informations et d’analyse des structures relationnelles, mais ne se sont que rarement intéressés à la définition des relations elles-mêmes. L’objectif de cet article est de proposer un cadre théorique permettant de définir les relations interpersonnelles et de préciser leur place dans l’ensemble des formes sociales. Le raisonnement est appuyé sur une étude empirique de réseaux personnels réalisée dans le sud de la France.
Mots-clés : mediation, relation, encastrement, découplage.
Abstract
Networks analysts have developed sophisticated methods of collecting and analysing relational data, but they have been rarely interested in the definition of the relations themselves. The aim of this article is to propose a theoretical framework allowing to define interpersonal relations, and to precise their place in the whole set of social forms. The reasoning is supported by a an empirical study of personal networks in the south of France.
Key words: mediation, relation, embedding, decoupling.
La plupart de ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux seront d’accord pour définir un réseau comme un ensemble de relations, qui n’implique en lui-même ni conscience organisatrice, ni sentiment d’appartenance, ni frontière. Les choses se compliquent un peu avec les composantes fondamentales du réseau que sont les relations sociales. En effet, à quelques exceptions près, la notion n’est pas définie au-delà des critères empiriques de repérage d’un type particulier de lien. Or une relation sociale n’est pas seulement une construction méthodologique, c’est aussi une réalité complexe vécue et perçue par les acteurs sociaux. Il est donc nécessaire de donner un statut théorique à cette notion. Mais cela implique de disposer en arrière-fond d’une conception d’ensemble du monde social et de la place qu’y prennent les relations et les réseaux, donc d’une théorie générale.
Une telle conception ne saurait se réduire au postulat méthodologique de « partir des relations », qui est un peu le credo commun des analystes de réseaux. Ce credo est parfaitement exprimé dans l’introduction d’un ouvrage collectif que l’on peut considérer comme une sorte de manifeste de l’analyse des réseaux comme paradigme sociologique (appelé « analyse structurale » dans ce livre). Dans cet ouvrage, Wellman et Berkowitz écrivaient ainsi : « Inversant la logique traditionnelle de l’enquête en sociologie, l’analyse structurale considère que les catégories sociales (e.g. classes, races) et les collectifs délimités sont mieux mis en évidence et analysés en examinant les relations entre les acteurs sociaux. Plutôt que de commencer par une classification a priori du monde observable dans un ensemble discret de catégories, ils commencent par un ensemble de relations, à partir duquel ils construisent des cartes et des typologies des structures sociales. » (Wellman and Berkowitz, 1988, p.3). Si ce choix méthodologique, — partir des relations — a produit des résultats d’une grande fécondité, il devient souvent dans les analyses de réseaux sociaux une sorte de réductionnisme. Les relations sont naturalisées et les auteurs oublient leur complexité et leur évolution, ce qui a été critiqué par l’un des fondateurs de cette approche, Harrison White (1995) : « Il faut noter (…) les difficultés soulevés par la notion de lien ou de relation, sur laquelle repose naïvement une grande partie de l’appareillage d’analyse des réseaux polyvalents. Une telle ambiguïté n’est pas vraiment surprenante : les liens commencent à résister à l’analyse parce qu’ils deviennent axiomatiques. » (White, 1995, p.712). En se centrant sur les relations, les analystes de réseaux sociaux tendent à laisser de côté les autres types de composants des structures sociales : les familles, les organisations, les collectifs, les communautés sont réduits à des ensembles de relations, elles mêmes définies de façon assez sommaire. Cela peut conduire à une vision très pauvre du monde social sous la forme d’un graphe de réseau dont les propriétés structurelles expliqueraient tous les phénomènes auxquels s’intéressent les chercheurs en sciences sociales.
Parmi les chercheurs qui pratiquent l’analyse de réseau, plusieurs ont cherché à dépasser cette conception un peu sommaire. Au premier rang de ceux-ci figure Harrison White (1992, 2008), pour qui les relations ne constituent qu’un élément dans un vaste ensemble de ce qu’il appelle parfois des « contextes » (et que souvent il ne nomme pas explicitement), et que je nommerai des « formes sociales ». Ces formes (« netdoms », « disciplines », « styles », « régimes », « institutions », etc.) sont des constructions théoriques originales qui se substituent aux collectifs, espaces sociaux ou autres champs de la littérature sociologique. Dans cet ensemble, les relations dyadiques sont des constructions analytiques extraites par le chercheur d’un ensemble des récits que produisent en permanence les acteurs : « Chaque lien qui persiste résume des luttes pour le contrôle. Chaque lien est un équilibre métastable entre des tentatives rivales de contrôle, et induit à ce titre des descriptions régulières. Les liens décrivent les connections, mais il ne s’agit pas d’interconnections éternelles entre des identités fixes. Les liens reflètent toujours l’activité telle qu’elle est perçue par les observateurs et les participants, mais ils sont aussi impliqués dans cette activité, comme peuvent le voir les observateurs aussi bien que les participants. L’accumulation des descriptions, et leur évocation aussi dans d’autres liens, les structure en modèles qui tendent à être perçus comme des récits. » (White, 2008, chapitre 2). En mettant l’accent sur la dimension discursive ou narrative de la vie sociale, la conception de White rejette les effets de naturalisation des liens auxquels pourrait conduire l’analyse des réseaux et ouvre des perspectives très stimulantes. Mais sa définition des relations est trop ambiguë et trop dépendante de sa propre théorie pour constituer un outil robuste. Alexis Ferrand, un autre analyste de réseaux, a proposé récemment, dans une perspective sociologique plus classique, une définition des relations fondée sur le type de régulation qui s’y opère. Ferrand définit trois types de régulations selon que celles-ci s’effectuent à partir de rôles et de normes (ce qu’il appelle « régulation catégorielle »), d’une position dans la structure d’ensemble du réseau (« régulation réticulaire »), ou encore de la confiance réciproque fondée sur les interactions passées entre les deux partenaires (« régulation dyadique ») (Ferrand, 2007). Cette définition est très claire et constitue un bon cadre de référence, mais elle inclut dans les relations des interactions éphémères comme celles qui se produisent fréquemment dans les échanges marchands par exemple, aussi bien que des interdépendances résultant de la position dans les réseaux de deux acteurs sans contact direct entre ces acteurs. Dans les deux cas, on va bien au-delà de ce que les analystes de réseaux considèrent implicitement ou explicitement comme des relations.
Ces deux exemples montrent qu’il n’est pas si facile de définir les relations sociales de façon rigoureuse, tout en restant au plus près des travaux habituels sur les réseaux. Le projet de cet article est de proposer une conception des relations et des réseaux sociaux qui soit la plus compatible possible avec les travaux existants, tout en dépassant le réductionnisme relationnel qui en caractérise beaucoup. Il s’appuie pour cela d’une part sur des études empiriques de réseaux personnels, dont celle d’une population d’habitants de la région de Toulouse qui reprend une méthode classique, et d’autre part sur une théorie faisant des réseaux un type de forme sociale parmi d’autres (Grossetti, 2004), et mobilisant certaines idées issues des travaux conduits dans la lignée de ce qui a été popularisé sous la dénomination de « théorie de l’acteur-réseau ». Dans une première section, j’argumenterai à partir de résultats empiriques la nécessité de ne pas réduire le monde social à un réseau, et de comprendre comment les relations interpersonnelles s’articulent à des engagements dans des formes collectives de nature différente. Ensuite je discuterai d’un point de vue théorique ces formes collectives, en mettant en avant la notion de ressource de médiation pour désigner ce qui permet aux acteurs de se coordonner dans une organisation, ou plus généralement dans un collectif, sans se reposer intégralement sur des relations personnelles. Je montrerai que l’articulation entre collectifs et relations personnelles se comprend très bien à partir des notions d’encastrement et de découplage, partiellement reformulées à partir de la version qu’Harrison White en a proposé. Je conclurai sur une définition des relations sociales.
1. D’où viennent les relations personnelles ?
Pour comprendre les relations qui constituent les réseaux, il faut sortir d’emblée du réductionnisme relationnel qui fait des relations la composante unique de la structure sociale tout en négligeant de les définir. Une bonne façon de se convaincre que le monde social ne se réduit pas à un réseau est de poser la question de l’origine des relations sociales. Partons de celles-ci comme nous y invite l’analyse structurale, mais au lieu de nous demander ce qu’elles produisent, essayons de comprendre d’où elles viennent.
Claude S. Fischer, qui dirigea une enquête empirique très importante sur les réseaux personnels à la fin des années 1970 résumait ainsi ses conclusions : « La plupart des adultes rencontrent les gens par leur famille, au travail, dans le quartier, dans les organisations, ou par l'intermédiaire d'amis ou de parents ; ils continuent à voir certaines personnes rencontrées dans des situations antérieures, comme l'école ou l'armée ; il est rare que des rencontres contingentes, dans un bar, une salle des ventes ou autre, deviennent autre chose que de brèves rencontres » (Fischer, 1982, p.4). Autrement dit, dès que l'on pose la question de l'origine des relations individuelles, on retrouve des cadres collectifs (organisations, familles, etc.) au sein desquels elles se forment le plus souvent avant de prendre leur autonomie. E. Goffman ne dit pas autre chose : « La plupart des relations ancrées naissent, semble-t-il, pour des raisons qui leur sont extérieures et sont le résultat direct et immédiat de dispositions institutionnelles, (On peut citer en exemple les frères et sœurs, les clients, les collègues de travail, les voisins) (…) Bien entendu, ces contacts [au cours desquels se nouent des relations] renvoient eux-mêmes aux organisations sociales qui en constituent le cadre large et l'occasion : voisinage, écoles et facultés, lieux de travail, réceptions, villégiatures et ainsi de suite » (Goffman, 1977, pp.136-137). Plus récemment, dans son beau travail sur l'amitié, Claire Bidart va dans le même sens : « On ne trouve pas des amis dans la rue, dans la foule, à partir de rien. Certains cadres, certains lieux, certains milieux sont relativement favorables à la construction de liens interpersonnels, alors que d'autres la rendent très difficile » (Bidart, 1997, p.52).
J’ai pour ma part dirigé en 2001 une enquête qui transpose la méthode utilisée en 1977 par Claude Fischer dans la région de San Francisco (Fischer, 1982). Cette enquête a été réalisée dans l’agglomération de Toulouse et dans une zone rurale située à une heure de voiture de Toulouse (Grossetti, 2005, 2007). Elle utilise une série de générateurs de noms qui permettent de constituer une liste de relations (27 en moyenne dans l’enquête de Toulouse) dont on extrait un sous-échantillon de 5 relations maximum pour des questions complémentaires. 399 personnes ont été interrogées (300 dans l’agglomération de Toulouse et 99 dans un canton rural du Tarn). Elles ont cité 10932 personnes dont 1624 ont fait l’objet de questions complémentaires dont l’une portait sur les contextes initiaux de rencontre avec les personnes citées. Pour 1606 d’entre elles, l’origine de la rencontre a été donnée avec suffisamment de précision par l’enquêté. Le tableau 1 présente une catégorisation des réponses.
|
Tableau 1. Contextes de construction des relations sociales (Enquête Toulouse, 2001)
Ces catégories et ces proportions sont bien sûr dépendantes de la procédure d’enquête et de la sélection de la sous-population pour laquelle cette question a été abordée. Les résultats sont assez proches de ce qu’avait obtenu Fischer avec la même procédure pour une population de la région de San Francisco dans les années 1970, ce qui lui confère quand même une probable généralité.
Ce qui m’intéresse dans ces résultats, c’est que l’on voit apparaître, à l’origine d’une grande part des relations sociales, des contextes collectifs (familles et organisations) qui ne sont pas réductibles à la figure du réseau.
Nous avons vu au début de ce texte que le postulat des analystes de réseaux consiste à « partir des relations ». Mais si l’on part des relations pour remonter à leur origine, on ne trouve pas seulement d’autres relations, mais aussi et surtout des formes sociales différentes, que l’on peut difficilement ramener à de simples superstructures des réseaux. Il faut donc à présent opérer un petit détour théorique pour définir un peu plus précisément ces formes sociales qui sont à la fois alternatives aux réseaux et qui interagissent avec ceux-ci. Nous reviendrons aux relations ensuite, avec une base théorique plus solide.
2. Collectifs et médiations
Qu’est-ce qui différencie un réseau d’une organisation ou une famille, deux formes sociales que j’inclurai ici dans la notion générique de « collectif » ? Cette différence se perçoit très bien chez le sociologue des sciences Nicholas Mullins, l’un des rares auteurs a avoir conceptualisé le passage de l’un de ces types de forme sociale à l’autre, dans un travail sur l’émergence des spécialités scientifiques : « Un collectif se forme lorsque les chercheurs deviennent conscients de leurs structures de communication et commencent à tracer des frontières autour de ceux qui travaillent sur leur problème commun. Il se développe par recombinaison des paires et des triades en réponse à des conditions favorables, e.g. la chance, le leadership, un problème substantiel de recherche, une ou plusieurs institution(s) de support. Ces collectifs sont souvent identifiés par un nom, à la fois par ceux qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur, sont plus stables que les paires ou les triades qui les constituent, ont une culture spécifique et sont capables d'obtenir des moyens et des étudiants. » (Mullins, 1972, p.69)[2].
Le collectif de Mullins émerge d’un réseau préexistant, qu’il contribue à reconfigurer. Il présente des ingrédients qui ne sont en rien nécessaires à l’existence d’un réseau : des frontières, un nom, une culture spécifique, un récit sur l’histoire du collectif en question, des critères plus ou moins explicites d’appartenance, des ressources plus ou moins partagées. Comment qualifier ces ingrédients ? Le plus simple est de les considérer comme des ressources, dont certaines permettent aux membres du collectif de se coordonner sans nécessairement s’appuyer sur des relations interpersonnelles. Ici nous pouvons reprendre une idée avancée par Antoine Hennion, un auteur proche par certains aspects des travaux connus sous le nom de « théorie de l’acteur-réseau », qui a développé la notion de « médiation » pour désigner tous les acteurs sociaux, les dispositifs techniques ou les objets ordinaires faisant le lien entre les acteurs. Travaillant sur la renaissance de la musique baroque dans les trente dernières années, Hennion montrait qu’on ne pouvait pas comprendre ce qui s’est passé sans tenir compte des partitions, des musicologues et de leurs ouvrages, des instruments eux-mêmes. Appelons « ressources de médiation » tous ces éléments qui relient les acteurs entre eux sans être pour autant des relations sociales au sens que leur donnent les analystes de réseaux et que je cherche à préciser dans ce texte. Un collectif se définit donc par l’accès des membres à des ressources communes dont certaines au moins opèrent des médiations entre ces membres. Evidemment, les membres du collectif ne sont pas égaux dans l’accès à ces différentes ressources, mais leur qualité de membre leur donne au moins une possibilité d’accès qui n’existe pas pour des acteurs extérieurs au collectif. Tout aussi évidemment, les contours du collectif ne vont pas nécessairement de soi et peuvent faire l’objet de luttes de définition, de transgressions de toutes sortes, ils constituent en définitive une ressource comme une autre.
Pour préciser l’idée de médiation, on peut aussi prendre l’exemple célèbre de l’étude de l'accès à l'emploi par Granovetter (1974). Dans cette étude, si 56% des emplois avaient été trouvés par l'intermédiaire de relations sociales, 44% avaient été obtenus par d'autres moyens : candidatures spontanées, réponse à des annonces, passage par des agences de recrutement, etc. Envoyer une candidature spontanée suppose que l'on dispose d'informations sur une entreprise (adresse, activité, etc.). Si ces informations ne sont pas obtenues par des relations, elles peuvent l'être par la consultation d'annuaires ou de la presse économique par exemple. Ce sont là deux exemples de ressources de médiation structurant le marché du travail. De la même façon, une agence de placement ou de recrutement constitue une ressource de médiation. Dans tous ces cas, ces ressources ont été conçues et disposées pour produire des médiations, aider les demandeurs d’emploi et les offreurs à entrer en contact. Nous pourrions utiliser l’expression « dispositif de médiation » pour désigner une ressource ou un ensemble de ressources conçues pour opérer des médiations. Si j’ai privilégié le terme de « ressource », c’est que les médiations peuvent s’opérer à partir de lieux, d’objets ou de personnes dont ce n’est pas explicitement le rôle. Il suffit de penser au cas de vendeurs à la sauvette pour lesquels la médiation avec les clients est constituée par le lieu lui-même (on sait que l’on a des chances de trouver tel vendeur dans telle rue ou telle place).
L’exemple des petites annonces ou des agences de recrutement montre que les ressources de médiation ne se limitent pas aux collectifs explicites reconnus comme tels par leurs membres, comme peuvent l’être les organisations ou les familles. Elles peuvent aussi structurer des collectifs aux contours plus flottants qui n’engendrent pas nécessairement un sentiment d’appartenance, comme des marchés par exemple (le marché du travail analysé par Granovetter). Prenons l’exemple d’une ressource de médiation classique, un journal. Ceux qui lisent un journal peuvent avoir le sentiment d’appartenir à une communauté de lecteurs, surtout s’ils le lisent très régulièrement, mais ils peuvent aussi considérer le journal comme une simple source d’information totalement substituable à une autre. On peut toujours circonscrire analytiquement un collectif à partir des lecteurs du journal, et c’est d’ailleurs ce que font les dirigeants du journal et les journalistes en s’appuyant sur les statistiques de vente et les études de marché, mais ce collectif a des frontières floues et une identité fluctuante. Pour certains journaux très militants, le collectif des lecteurs présente une stabilité et une identité forte, il se rapproche d’une organisation, alors que pour des journaux plus génériques ce collectif est plus fluctuant et associe un noyau de lecteurs réguliers à des lecteurs occasionnels, attirés ponctuellement par un titre ou une information.
Les collectifs sont donc des formes sociales spécifiques caractérisés par la mise en commun entre acteurs de certaines ressources, dont certaines sont des ressources de médiation leur permettant de se coordonner sans s’appuyer intégralement sur des relations interpersonnelles. Nous avons vu dans la première partie de ce texte que ces collectifs, et les ressources de médiation qui leur sont spécifiques, sont souvent à l’origine des relations interpersonnelles. L’étude de Mullins montre aussi que les collectifs peuvent se construire à partir de réseaux de relations dyadiques. Il faut donc rendre compte des interactions entre les collectifs, les relations et les réseaux. Plus précisément il faut inscrire ces interactions dans une dynamique globale d’émergence ou de changement des différentes formes sociales. Pour cela, il est nécessaire de sortir d’une conception statique du monde social dans laquelle les choses existent ou n’existent pas pour adopter une conception plus dynamique dans laquelle elles émergent ou se dissolvent.
3. Encastrements et découplages
Pour analyser cette dynamique des formes sociales, on peut utiliser les notions d’encastrement et de découplage que j’ai été amené à redéfinir en partie (Grossetti, 2004) en partant du sens que leur a conféré Harrison White (1992, 2002). Dans le présent texte, l’encastrement est l’accroissement des dépendances d’une forme sociale vis-à-vis d’une autre et le découplage est le processus réciproque d’autonomisation. Lorsqu’un collectif émerge par rapport au réseau qui lui a donné naissance, il s’en découple : alors que son fonctionnement est au départ totalement dépendant du réseau, de sa structure et de ses acteurs les plus centraux, il acquiert grâce aux ressources de médiation une autonomie relative, dont le test est sa capacité à survivre au départ de certains acteurs centraux. En même temps, il s’intègre dans un réseau composé d’autres collectifs du même type, donc se « réencastre », mais à un niveau différent. Les processus d’encastrement et de découplage à différents niveaux sont en tension permanente, mais ils peuvent se stabiliser pour un moment à un niveau donné de dépendance entre les entités impliquées. Pour une organisation, cet équilibre peut se situer à un très haut niveau de dépendance par rapport aux individus et à leurs relations, à tel point que le départ d’un seul acteur ou la rupture d’une seule relation peut amener une reconfiguration importante du collectif ou même sa disparition. Ou encore, l’organisation peut avoir constitué des ressources de médiation si puissantes qu’elle se révèle insensible aux changement de ses membres et de leurs relations, que ceux-ci sont à la limite totalement substituables. En réalité les organisations peuvent se trouver dans toutes les situations intermédiaires et passer d’une situation à une autre au fil du temps. A des niveaux d’action plus vastes, les mêmes notions fonctionnent très bien. Au fond, l’émergence de l’économie de marché comme sphère relativement autonome correspond à la constitution de dispositifs juridiques et matériels qui sont autant de sources de sources de découplage (Polanyi, 1983). Au niveaux intermédiaires que constituent des marchés particuliers, on peut mesurer des degrés d’autonomisation des échanges par rapport aux relations personnelles et par rapport à d’autres marchés ou sphères d’activité. Ainsi, si dans le marché du travail en France, entre 30 et 40% des emplois sont trouvés par relations (Forsé, 1997), alors cela signifie que le découplage de ce marché, qui passe par toutes les médiations que j’ai citées plus haut ainsi que par d’autres, plus spécifiques (en France les concours de la fonction publique par exemple), s’est stabilisé à un niveau limité d’autonomie vis-à-vis des relations personnelles. En revanche, on peut supposer que le nombre d’achats en hypermarché effectué sur la base de relations personnelles avec les vendeurs est extrêmement faible, ce qui autonomise le marché de la « grande distribution » vis-à-vis des réseaux sociaux, mais le rend aussi plus dépendant de tous les dispositifs et professionnels du marketing, du packaging et autres activités de médiation (Cochoy, 2002).
Le découplage d’organisations ou de collectifs implique la création de ressources de médiation qui permettent de s’affranchir des caractéristiques des acteurs individuels et de leurs relations. Leur encastrement en revanche se mesure à l’inefficacité de ces ressources et à l’importance prise par les réseaux interindividuels dans leur activité. Jusque là nous avons raisonné « du bas vers le haut » ou « du micro vers le macro », c’est-à-dire des acteurs et de leurs relations vers les organisations ou les marchés. Mais on peut renverser la perspective et poser la question de l’encastrement et du découplage des relations interpersonnelles par rapport à leur contexte d’émergence.
Nous pouvons donc à présent revenir au problème de l’émergence des relations, en disposant d’un cadre théorique plus solide.
4. Typologie des contextes d’émergence des relations
Nous avons vu plus haut que dès que l’on aborde empiriquement la question de l’émergence des relations interpersonnelles, on trouve des collectifs : la famille, l’organisation de travail, les associations de loisirs, etc.
Prenons l’exemple d’une personne recrutée dans une entreprise. Elle est amenée par l’organisation à nouer des relations avec d’autres membres de l’entreprise. Supposons à présent que l’entreprise soit en faillite. Les employés vont trouver du travail ailleurs. Une bonne partie des liens faibles qu’ils avaient tissés disparaît. Mais certains liens survivent à la disparition du collectif. Pour des raisons très variables (affinité intellectuelle, proximité sociale, compatibilité des entourages) ils se sont renforcés et ne sont plus des relations de travail mais des liens qui seront qualifiés en général d’amicaux par les protagonistes. Que s’est-il passé ? Au départ ces relations étaient cadrées très fortement par l’organisation de l’entreprise, la division du travail, les procédures. Puis elles se sont progressivement découplées. Ce découplage ne nécessite pas la disparition du cadre que constitue l’entreprise, disparition que j’ai introduite ici pour contraster et dramatiser un peu la situation. Il commence lorsque la relation dépasse les rôles prévus par l’organisation, lorsqu’elle se personnalise, que les protagonistes ne sont plus substituables l’un par rapport à l’autre. Ce découplage est toujours en tension avec l’encastrement qui résulte de la discipline de l’entreprise. Une relation créée dans le cadre d’un collectif se développe toujours à la marge des règles du collectif et en contradiction partielle avec son intégrité, son identité en tant que collectif.
|
|
Figure 1. Des collectifs aux relations.
Les relations peuvent donc être encastrées dans des entités plus larges, des collectifs. Elles peuvent aussi s’encastrer dans leurs composants, la suite des interactions. Le découplage de la relation c’est aussi la constitution d’une histoire partagée qui permet à la relation d’acquérir une consistance qui dépasse la simple addition des échanges. Le découplage a évidemment quelque chose à voir avec la force du lien : une des caractéristiques d’un lien fort est d’être peu substituable.
Mais les relations ne naissent pas seulement dans les collectifs. Un part importante d’entre elles naît de l’existence d’autres relations : être en relation avec quelqu’un c’est accroître la probabilité d’entrer en contact avec ceux avec qui il est en relation. Par le biais des présentations, des recommandations ou des parrainages, le réseau se complète en quelque sorte de lui même sans nécessairement mettre en jeu des collectifs.
|
|
Figure 2. Des relations aux relations.
Dans ce second cas de figure, on peut aussi voir la construction de la troisième relation directe comme un découplage par rapport aux échanges qui passaient auparavant par l’intermédiaire de l’« ami commun », donc par rapport au réseau. Le découplage peut se mesurer par la capacité des protagonistes à échanger en l’absence de l’intermédiaire, et par la capacité de la relation à résister à la disparition de l’intermédiaire. Mais en même temps que la relation apparaît et se découple, elle prend sa place dans le réseau et donc s’y encastre.
Enfin, il existe un troisième type de contexte de création des relations. C’est le cas où les deux protagonistes sont rapprochés par leur intérêt pour une même ressource, un même enjeu. L’analyse de la constitution de la biologie moléculaire par Mullins, déjà évoquée plus haut, est ici à nouveau un très bon exemple. Pourquoi les chercheurs entrent-ils en contact les uns avec les autres au départ ? Mullins évoque des chercheurs « qui sont passés d'un point de vue à un autre, et qui sont ou non en communication. (…) un ensemble d'individus tel que tous se retrouvent dans une même situation cognitive par rapport à un même problème ou à des problèmes similaires » (Mullins, 1972, p.55). Ces chercheurs peuvent être rapprochés par des lectures communes (dans ce cas, un article fondateur de Shrödinger). Les acteurs sont liés ici à une même ressource cognitive, ce qui les rapproche et amène certains d’entre au moins à tenter de rencontrer les autres. Cet exemple se généralise assez facilement à tous les cas où des chercheurs entrent en contact lors d’un colloque : s’ils viennent y participer c’est parce qu’ils partagent des intérêts. Ces rencontres sont bien sûr facilitées par des collectifs qui les cadrent dans une certaine mesure : la communauté scientifique générale dans le cas de la biologie moléculaire, tel collectif disciplinaire pour un colloque. Les rencontres sont induites par le rapport à une même ressource mais elle s’appuient sur d’autres ressources partagées au sein du collectif. La différence avec le premier type de rencontre, directement induit par un collectif, c’est que dans cette situation, les acteurs ne sont pas mis en contact par leur simple présence dans le collectif. Le collectif est suffisamment vaste pour qu’ils puissent ne jamais être en contact s’ils ne partagent pas un même intérêt à un moment donné. Le collectif est donc dans ce cas un simple cadre. On peut généraliser encore cet exemple aux rencontres entre amateurs d’une même activité de loisir et aux relations avec des commerçants ou des professionnels de proximité. On peut aussi inclure dans ce type certaines rencontres amoureuses, qu’elles soient issus de situations de « drague » dans des lieux anonymes ou dans des lieux spécifiques (boîtes de nuit), voire à des moments spécifiques (bal). L’enjeu est ici finalement la relation sociale elle-même. Enfin pour achever cette liste, qui n’est certainement pas exhaustive, il faut mentionner les relations avec les voisins, dont un des aspect est le partage d’intérêts communs (une mitoyenneté à gérer, des espaces publics communs, etc.).
|
|
Figure 3. Des enjeux communs aux relations.
Le découplage se produit ici à plusieurs niveaux. Il y a tout d’abord l’effacement relatif de l’objet intermédiaire au profit du lien direct, comme dans le cas précédent. Il y a aussi, comme dans le premier type de contexte de rencontre, le découplage par rapport aux collectifs dans lesquels la relation est éventuellement inscrite. Le découplage se mesure par la capacité de la relation à survivre à la disparition éventuelle des éléments intermédiaires ou à la sortie du collectif.
Pour autant, les relations ne restent pas nécessairement prisonnières des contextes dans lesquelles elles se créent : elles s’en découplent. Dans l’étude sur les réseaux personnels des habitants de la région de Toulouse, nous avions demandé aux enquêtés de qualifier les personnes citées selon une série de rôles relationnels classiques (famille, collègues, voisins, membres d’associations, etc.). Lorsque l’on compare ces qualifications aux désignations des contextes de création des relations on observe beaucoup de changements. Certains contextes ont disparu : c’est le cas par exemple de l’école ou de l’université. Les personnes qui ont rencontrées à l’université et qui sont citées dans cette enquête sont devenus des conjoints (13%), des amis (la plupart des autres), mais aussi souvent des collègues (38%). On peut percevoir l’amplitude de l’évolution des relations par rapport à un contexte d’origine en prenant le cas des relations de travail (tableau 2). J’ai fait figurer dans ce tableau la proportion de personnes considérées comme proches dans chaque catégorie, afin de montrer la variabilité des types de relations nées dans le cadre du travail, selon leur évolution ultérieure.
|
Contexte de rencontre |
Désignation actuelle |
Effectif |
% |
% proches |
|
Travail |
Collègue seulement |
33 |
15% |
21 |
|
Travail |
Collègue et ami |
66 |
29% |
64 |
|
Travail |
Ami seulement |
82 |
36% |
48 |
|
Travail |
Conjoint ou famille |
29 |
13% |
90 |
|
Travail |
Autre désignation |
15 |
7% |
0 |
|
Total travail |
225 |
100% |
48 |
|
|
Autre |
Collègue seulement |
9 |
17% |
0 |
|
Autre |
Collègue + ami |
44 |
83% |
52 |
|
Total collègues rencontrés hors travail |
53 |
100% |
53 |
|
Tableau 2. Anciens et actuels «collègues».
La qualification d’« ami » est une sorte d’attracteur des relations lorsque celles-ci acquièrent de l’intensité (ce dont témoigne le fait que les enquêtés désignent les personnes concernées comme proches). Le tableau 3 récapitule les contextes de création des relations avec ceux qui sont considérés au moment de l’enquête comme des amis.
|
Contexte de rencontre |
Amis |
% |
% pour l’ensemble des relations (hors famille) |
|
Même famille |
21 |
3% |
|
|
Ecole |
53 |
7% |
7% |
|
Grandi ensemble |
14 |
2% |
2% |
|
1. Famille / enfance |
11 |
12% |
9% |
|
|
|
||
|
Etudes supérieures |
62 |
9% |
7% |
|
Travail |
155 |
22% |
19% |
|
Associations |
62 |
9% |
8% |
|
2. Etudes sup. / travail / assocs |
29 |
40% |
34% |
|
|
|
|
|
|
3. Voisin |
46 |
6% |
11% |
|
|
|
||
|
Par les enfants |
55 |
8% |
10% |
|
Par le conjoint |
51 |
7% |
9% |
|
par un autre ami |
140 |
19% |
18% |
|
4. Sociabilité (“par…”) |
21 |
34% |
37% |
|
|
|
||
|
5. Autre (hasard, etc.) |
62 |
9% |
9% |
|
|
|
|
|
|
Total |
719 |
100,0 |
100% |
Tableau 3. Les contextes de rencontres des «amis».
On se rend compte que les amis se créent dans les mêmes contextes que les relations considérées de façon plus générale, à ceci près que la famille y joue évidemment un rôle très restreint (les « amis » rencontrés au titre de la famille sont le plus souvent des cousins éloignés). Le passage d’un contexte précis (un collectif comme ceux des études ou travail, une relation intermédiaire ou un enjeu commun) à une désignation comme celle d’« ami » est un indice du découplage des relations concernées. Comment s’opère ce découplage ?
Poser la question du découplage des relations, revient à s’interroger sur ce qui les constitue et qui s’écarte de ce qu’elles héritent de leur contexte d’origine. Dans le cas des collectifs, nous avons vu que le découplage implique la création de ressources de médiation. Il doit donc en être de même pour les relations. Que sont ces ressources de médiation spécifiques aux relations ?
5. Qu’est-ce qu’une relation interpersonnelle ?
Nous pouvons à présent essayer de définir les relations interpersonnelles.
J’ai écrit plus haut que le découplage d’une relation à partir d’un contexte de travail s’amorce lorsque la relation dépasse les rôles prévus par l’organisation, lorsque les protagonistes ne sont plus substituables l’un par rapport à l’autre. Qu’est-ce qui fait que deux personnes ne sont plus substituables l’une par rapport à l’autre ? La première réponse qui vient logiquement à l’esprit est qu’au fil des interactions chacune d’entre elles acquiert sur l’autre des informations qu’elle prend en compte dans son propre comportement. On peut appeler cela une connaissance réciproque. Cette connaissance produit un ajustement des partenaires l’un par rapport à l’autre.
On peut très bien définir les relations interpersonnelles uniquement à partir de la connaissance réciproque des partenaires. Mais il est facile de montrer que cela ne suffit pas pour correspondre au sens habituel que l’on donne à ces relations dans les analyses de réseaux sociaux. D’abord la connaissance réciproque peut se construire sans interactions directes entre les partenaires, les informations passant par des intermédiaires (bouche à oreille) ou par des ressources génériques de médiation (médias). Mais, même si l’on impose que cette connaissance se soit construite dans des interactions, cela ne suffit pas nécessairement. En effet, une telle connaissance peut très bien se construire entre des adversaires, que ce soit dans un sport ou dans un conflit. Or, un des implicites de la plupart des analyses de réseaux est que les relations sont suffisamment non conflictuelles pour que des ressources puissent circuler. Bien sûr, des ressources circulent même lorsqu’il existe un conflit ou une adversité entre les partenaires. Par exemple lorsque dans un conflit, l’un des protagonistes met en œuvre une nouvelle tactique, il donne une information que son adversaire peut décrypter, de telle sorte qu’il peut lui-même tenter d’adopter cette tactique. Toutefois, nous supposons en général dans les analyses de réseaux que, même si les personnes en relation peuvent être rivales, elles sont aussi engagées dans une sorte de coopération, même minimale. Pour spécifier cela, la notion d’engagement peut se révéler très utile (Chaulet, 2007). Etre engagé dans une relation sociale vis-à-vis d’une autre personne, c’est accepter par avance une coopération, même minimale. On peut bien sûr être engagé en quelque sorte négativement dans un rapport antagonique avec une personne. Je m’en tiendrai dans ce qui suit à l’engagement « positif », qui implique une coopération.
Le degré minimum de l’engagement relationnel est probablement de reconnaître que l’on est en relation avec quelqu’un. Il suffit d’imaginer une personne qui en rencontre une autre dans une soirée et s’adresse à elle en évoquant leur relation commune. La personne interpellée peut ignorer cette évocation et se comporter comme si celle qui s’adresse à elle lui était inconnue. Elle manifeste ainsi son refus de reconnaître un quelconque engagement vis-à-vis de l’autre. A l’inverse, si elle décide de manifester son engagement, les autres participants décèleront immédiatement l’existence d’une relation à partir des attitudes des protagonistes et de leur façon de s’adresser l’un à l’autre. « Une connaissance et un engagement réciproques fondés sur des interactions » est donc une définition possible de la relation sociale entre deux personnes. La notion d’engagement permet de passer assez facilement aux relations entre des organisations ou des collectifs puisque l’engagement peut prendre une forme contractuelle.
On peut considérer la connaissance et l’engagement comme des ressources de médiation qui ont pour effet de cadrer les interactions de façon spécifique. Interagir avec une personne avec laquelle on est en relation implique des allant de soi et des références qui sont plus spécifiques que ceux qui résultent de l’inscription dans un collectif ou un contexte plus larges. La connaissance et l’engagement produisent une autre ressource de médiation, qu’on associe souvent à la notion de relation sociale, la confiance (Cook, 2001). C’est une notion très complexe. La confiance faite à une personne ne fonctionne pas de façon binaire (oui ou non) : on peut avoir confiance dans l’attitude de l’autre (sa bienveillance par rapport à nous ou son honnêteté) mais pas dans sa capacité à résoudre tel problème, ou l’inverse. La confiance peut se diffracter en une myriade d’aspects dont certains vont aller de soi et d’autres impliquer une réflexion. Mais ce qui est important c’est que toute relation entre personnes s’accompagne de l’existence d’une certaine confiance entre ces personnes. Cette confiance peut s’ajouter ou se substituer à celle qu’engendrent des dispositifs collectifs, mais elle en diffère fondamentalement. Les médiations spécifiques aux relations interpersonnelles ne s’étendent pas au-delà des partenaires de la relation. Appelons-les des médiations dyadiques. Nous pouvons compléter notre définition de la relation interpersonnelle : « Une connaissance et un engagement réciproques fondés sur des interactions débouchant sur des formes spécifiques de confiance entre les partenaires ».
Conclusion: formes sociales et aire d’efficience des médiations
Les acteurs se coordonnent à travers des ressources de médiation. Ces ressources sont très diverses. Elles peuvent être de nature cognitive (langage, information, normes culturelles, rôles sociaux, …), matérielles (moyens de communication, médias, marques physiques de délimitation des espaces, signalétique …). Chacune d’entre a une aire d’efficience, que l’on peut définir pour faire simple comme l’ensemble des acteurs pour qui elle fonctionne comme ressource, contrainte et enjeu. Par exemple, l’aire d’efficience d’un journal peut être définie par son lectorat, celle d’une loi par l’ensemble de ceux auxquels elle s’applique, celle d’une barrière canalisant une file d’attente dans un aéroport par l’ensemble des voyageurs concernés, etc. Ces amplitudes sont évidemment très variables. Les médiations dyadiques ne concernent que deux personnes. Dès lors qu’elles concernent au moins trois personnes, on se trouve face à un collectif. Ce qui distingue le collectif du réseau c’est la forme de partage des ressources de médiation, qui sont spécifiques à chaque relation dans le réseau alors qu’elles sont (au moins théoriquement) partagées dans le collectif. Alors que les ressources circulent le long des chaînes relationnelles dans le réseau, elles sont accessibles selon des règles d’accès dans un collectif.
Une relation interpersonnelle est donc un ensemble de ressources de médiations dyadiques (c’est-à-dire spécifiques aux protagonistes de la relation) qui permet la coordination entre les acteurs, la circulation ou la transmission de ressources.
Références
Bidart Claire y Lavenu Daniel (2005). "Evolutions of personal networks and life events", Social Networks, 27, n°4, pp. 359-376.
Chaulet Johann (2007), « La confiance médiatisée. La confiance et sa gestion au sein des communications médiatisées », thèse de sociologie, Université de Toulouse 2 Le Mirail.
Cochoy Franck (2002). Une Sociologie du Packaging ou l'âne de Buridan face au marché. París : PUF.
Cook Karen S. (dir.) (2001). Trust in society. New-York:Russel Sage Foundation.
Degenne Alain y Forsé Michel (1994). Les réseaux sociaux. París : Armand Colin.
Ferrand A., 2006, "Redes heterogéneas de discusión y pluralismo cognitivo.", REDES. Revista hispana para el análisis de redes sociales. Vol.10, art. 2, julio 2006. http://revista-redes.rediris.es/pdf-vol10/vol10_2.pdf
Fischer Claude S. (1982). To Dwell Among Friends. Chicago: University of Chicago Press.
Granovetter Mark S. (1973). "The strength of weak ties." American Journal Of Sociology, Vol. 78, pp.1360-1380.
Granovetter Mark S. (1974). Getting a job. Harvard: Harvard University Press
Granovetter Mark S. (1985). "Economic action and social structure : the problem of embeddedness". American Journal of Sociology, Vol. 91, pp.481-510.
Grossetti Michel y Bès Marie-Pierre (2001). "Encastrements et découplages dans les relations science – industrie "., Revue Française de Sociologie, Vol. 42, n°2, pp.327-355.
Grossetti Michel (2004). Sociologie de l’imprévisible. Dynamiques de l’activité et des formes sociales. Paris : PUF.
Grossetti Michel (2005). "Where do social relations come from?: A study of personal networks in the Toulouse area of France", Social Networks, Vol. 27, pp.289-300.
Grossetti Michel (2007). "Are French networks different ? " Social Networks, Vol. 29, n°3, pp. 391-404.
Hennion Antoine (1993). La passion musicale. Une sociologie de la mediation. Paris: Metailié.
Mullins, Nicholas C. (1972). “The Development of a Scientific Speciality: the Phage Group and the Origins of Molecular Biology”, Minerva, vol.19, p. 52-82.
Wellman Barry y Berkowitz Stanley D (1988). " Introduction : studying social structures" in Barry Wellman and S.D. Berkowitz (ed.), Social structures. A network approach, 1988, 1997, Greenwich USA and London GB: JAI Press, pp. 1-14
White Harrison C. (2002). Market from networks. Socioeconomic models of production, Princeton and Oxford: Princeton University Press,.
White Harrison C. (1995). "Passages réticulaires, acteurs et grammaire de la domination", Revue Française de Sociologie, Vol. 36, pp.705-723.
White. Harrison C. (1992). Identity and Control. A structural theory of social action. Princeton and Oxford: Princeton University Press.