Types d’interactions, formes de confiance et relations
Alain Degenne – CNRS[1]
Resumen
Existe una distancia importante entre la complejidad de las relaciones sociales, que son historias compuestas de interacciones múltiples, y la pobreza de los modelos de relación de los que se ocupa el análisis de las redes sociales. Volviendo a partir de las interacciones reconoceremos cuatro grandes categorías de formas fundadas en el análisis del modo de regulación. Examinaremos, entonces, una hipótesis sobre la distribución de las interacciones en las relaciones.
Palabras clave: confianza – interacciones – regulación – relaciones.
Abstract
There is an important gap between the complexities of social relations, which are histories made of multiple interactions, and the poverty of relations models in social network analysis. In this article, I start with interactions for distinguishing four categories of forms, which are base on the analysis of the mode of regulation. I then examine a hypothesis on the distribution of interactions in the relations.
Key words: trust – interactions – regulation – relations.
Résumé
Il existe un décalage important entre la complexité des relations sociales qui sont des histoires composées d’interactions multiples et la pauvreté des modèles de relation dont traite en général l’analyse des réseaux sociaux. On repart ici des interactions pour en reconnaître quatre grandes catégories de formes fondées sur l’analyse du mode de régulation. On examine alors une hypothèse sur la distribution des interactions dans les relations.
Mots-clés : confiance – interactions – régulations – relations.
1. Introduction : la question de la confiance
D’un point de vue technique, les acquis les plus importants de l’analyse des réseaux sociaux concernent des réseaux complets d’une seule relation, bien souvent non orientés. Ces acquis ne sont pas minces, ils constituent un corps de connaissances toujours en évolution rapide ; mais celui qui s’est un jour donné pour tâche de modéliser des relations concrètes a inévitablement expérimenté la difficulté de les transcrire sous forme d’un graphe sans appauvrir excessivement le contenu
On pourrait répondre que, comme il en va bien souvent, on a utilisé le modèle du graphe parce qu’il existait, qu’on le maîtrisait relativement bien. On pourrait répondre aussi que si l’on trouve des propriétés intéressantes sur la base d’un modèle, même simplificateur, il y a présomption de propriétés sociologiques importantes. Tout cela est sans doute vrai mais ne doit pas empêcher de chercher plus loin pour voir dans quelle mesure on pourrait tenter de rendre compte un peu mieux de la complexité des faits. Des solutions variées ont été envisagées pour retenir plusieurs types d’interactions (Sampson,1969), ou pour définir une typologie des formes d’interactions (Zeggelink, 1995, Monge & Contractor, 2003). C’est dans cette même direction que je m’engage ici, en esquissant une typologie des interactions fondée sur les modes de régulation.
Les développements des méthodes d’analyse des réseaux complets mettent en avant des idées variées : centralité, équilibre, cohésion, équivalence structurale, équivalence régulière etc.
Dans cet arsenal, l’équivalence occupe une place privilégiée car elle renvoie à des concepts fondamentaux de la sociologie.
Il me paraît intéressant d’introduire d’emblée un parallèle avec les notions de rapports en linguistique. On distingue les rapports horizontaux (axe syntagmatique) et les rapports verticaux (axe paradigmatique). Saussure parle plutôt de « rapports syntagmatiques et de « rapports associatifs » (Saussure, 1969 [1915]). Le syntagme est un groupe de mots qui forme une unité de sens, par exemple « il fait beau ». Il faut que ces mots soient réunis pour qu’on obtienne le sens recherché. Comme la phrase est linéaire et que ces mots s’écrivent les uns à la suite des autres, on parle d’axe horizontal. Les mots ne sont pas interchangeables ; c’est leur combinaison qui fait sens.
Mais j’aurais pu dire « il fait mauvais » ou « il fait sec ». Les mots « beau », « mauvais », « sec » apparaissent donc comme des alternatives dans ce syntagme. Du point de vue de la structure de la langue, ils sont interchangeables ; pas du point de vue du sens, bien sûr. On parle de l’axe vertical par référence à la représentation de ces deux associations, comme ci-dessous.
|
Il fait |
Beau |
Sec |
|
Mauvais |
Dans les réseaux on dit que deux individus sont équivalents s’ils ont les mêmes relations avec les autres. Ces individus sont comme les mots « beaux », « mauvais » et « sec » qui sont dans la même relation avec « il fait ». Si j’examine par exemple un réseau de coopération dans une entreprise, deux individus seront équivalents s’ils coopèrent avec les mêmes autres, ce qui ne signifie pas qu’ils coopèrent entre eux. Comme il est rare que deux personnes aient exactement les mêmes relations avec les autres, on opérationnalise plutôt cette notion sous la forme d’un indice qui mesure le degré de similitude entre les deux réseaux individuels. On parle dans ce cas d’équivalence structurale. Par rapport à leur environnement, des personnes fortement équivalentes sont donc interchangeables, comme les mots « beau », « mauvais », « sec », sont interchangeables dans la phrase. On pourrait fort bien employer le même terme d’équivalence pour les mots qui sont dans un même rapport d’association et dire que ces mots sont structuralement équivalents dans la phrase.
L’axe syntagmatique est au contraire celui des coopérations. Ici, il lie « il fait » avec « beau » et cela crée une entité nouvelle, une phrase.
Dans la société, il est des cas où l’axe syntagmatique est fondamental :Il s’agit des interactions que l’on peut qualifier de « corrélatives » en empruntant le terme à Ossowski (1971) c’est-à-dire des interactions dans lesquelles les partenaires sont dans des rôles complémentaires. Le professeur et l’élève, le médecin et le patient etc. Il n’y a pas de professeur s’il n’y a pas d’élève, il n’y a pas de médecin s’il n’y a pas de patient. C’est donc un partage des rôles dans l’interaction qui fait les classes corrélatives.
On voit bien que même si, formellement, on peut rapprocher une interaction de coopération entre des ouvriers ou des employés et une interaction de consultation entre un médecin et son patient ou entre un professeur et son élève, parce qu’elles s’apparentent à un rapport syntagmatique, leur sens est très différent et que ceci ne doit pas être négligé. Leur mode de régulation n’est pas le même, ce sont des formes d’interaction différentes.
Dans ce cas, l’axe syntagmatique devient très important car c’est l’interaction qui produit un fait social nouveau (le soin, l’enseignement). Les deux partenaires dans cette interaction ne sont pas interchangeables. L’axe paradigmatique, celui de l’équivalence est aussi fort important pour le sociologue, il définit les classes corrélatives : les médecins d’une part, les patients de l’autre, les élèves, les professeurs. La langue rend ainsi compte de cette importance puisqu’elle crée des mots spécifiques pour désigner la position des individus dans les interactions. Ce n’est pas le cas, en général dans la coopération, les partenaires ne sont pas distingués. Notons également que la compétition n’est possible qu’entre des individus équivalents. Les élèves peuvent être en compétition entre eux, les professeurs aussi mais les élèves ne peuvent pas être en compétition avec les professeurs. Quand il y a demande de conseils, ceux qui en demandent peuvent être en compétition, ceux qui en donnent également, mais ceux qui en demandent ne peuvent pas être en compétition avec ceux qui en donnent.
Si, au début j’ai employé le terme de relation, c’est parce que c’est celui que tout le monde emploie mais je vais tenter ici de préciser un certain nombre d’aspects et ceci requiert une clarification du vocabulaire. J’utiliserai donc le terme d’interaction pour désigner un échange élémentaire, de courte durée et représentant une unité d’action. J’emploierai relation pour désigner une suite d’interactions entre les mêmes personnes au cours du temps.
On ne s’intéressera aussi qu’aux interactions que les deux partenaires acceptent ; Ceci exclut donc le cas de la violence pure où l’une des parties est physiquement contrainte, séquestrée par exemple ou réduite en esclavage, contre sa volonté.
Qui dispose du pouvoir de définir les conditions dans lesquelles va se dérouler une interaction ? La question est essentielle. Ces conditions peuvent être négociées avec âpreté ou bien être totalement prédéfinies. On connaît bien par exemple, la différence entre les conditions dans lesquelles s’effectuent les achats de certains biens en Europe où la plupart des prix sont fixés à l’avance et peu négociables et dans certains pays d’Afrique où la négociation est une règle. Mais on peut évoquer bien d’autres circonstances : les rencontres entre chefs d’Etat font l’objet de négociations minutieuses, de même que les échanges de prisonniers entre belligérants. En revanche, les interactions au cours d’un procès dans un tribunal ou celles qui se passent entre les professeurs et leurs élèves dans une école obéissent à des règles prédéfinies. Là c’est l’organisation qui prime.
Toute négociation a un coût, ne serait-ce qu’en temps passé à la réaliser. Fixer les règles peut donc avoir pour objectif de minimiser les coûts de transaction. Un exemple simple, même s’il peut paraître banal est la définition du côté de la route sur lequel on doit circuler en voiture. Imaginons qu’aucune règle ne le définisse, les automobilistes seraient alors contraints de s’arrêter quand ils voudraient se croiser, afin de s’accorder sur le côté où ils vont circuler.
Coleman (1990) prend l’exemple d’un fumeur et d’un non fumeur qui sont dans une même pièce. Il examine ce qui se passe suivant que le fumeur ou le non fumeur pense détenir le droit de définir comment les choses vont se passer :
|
Cas |
Qui détient le droit ? |
Action |
|
|
|
Point de vue du fumeur |
Point de vue du non-fumeur |
|
|
1 |
Fumeur |
Fumeur |
Le fumeur allume une cigarette. Rien ne se passe |
|
2 |
Fumeur |
non-fumeur |
Le fumeur allume une cigarette, le non fumeur proteste |
|
3 |
Non-fumeur |
Fumeur |
Le fumeur ne fume pas ou il demande l'autorisation de fumer et le non fumeur lui répond qu'il peut le faire sans demander l'autorisation |
|
4 |
Non-fumeur |
non-fumeur |
Le fumeur ne fume pas ou il demande l'autorisation qui peut ou non lui être accordée |
En 1960, on était le plus souvent dans la situation n° 1. Aujourd’hui, on est presque systématiquement dans la situation n° 4, mais surtout c’est la loi qui a pris le pas sur la négociation pour fixer dans quelles conditions on peut ou non fumer en public. Alors que dans l’exemple de Coleman les partenaires sont dans une logique de confrontation, dans la réalité d’aujourd’hui, une règle a émergé qui s’impose à tous. L’organisation a pris le pas sur la confrontation.
Fixer des règles a surtout un intérêt lorsque la situation d’interaction va se reproduire, soit que les deux mêmes personnes soient destinées à se revoir, comme dans le cas du partage des tâches domestiques dans un couple, soit qu’elle concerne des personnes différentes qui seront placées dans des situations identiques, ce qui est le cas sur la route ou dans un magasin entre un acheteur et un vendeur.
Mais les règles peuvent aussi avoir pour but de maintenir une différence de rôle ou de statut : un militaire doit saluer son supérieur ; aucune négociation n’est possible.
On voit ainsi apparaître un critère fondamental dans l’analyse des interactions : dans quelle mesure le comportement de l’autre est-il prévisible ? S’il l’est complètement, même si la situation ne nous est pas favorable, on peut l’accepter. S’il n’est pas prévisible, il faut que d’autres considérations incitent à accepter l’interaction dans ces conditions.
On connaît des situations très artificielles que sont les jeux et les sports formalisés. Là les interactions s’effectuent dans un cadre très précisément codifié, dépourvu de toute ambiguïté. C’est la condition pour que le jeu soit accepté par tous et c’est la condition pour que le sport conserve ses qualités de spectacle universel (Parlebas, 1986).
L’échange économique a suscité de nombreux travaux et de nombreuses réflexions théoriques.
Supposons que nous sommes dans la rue ou dans le métro. Quelqu’un s’approche et propose à un passant une montre identifiée comme une montre Cartier, pour quelques dizaines d’Euros. Le passant a deux raisons de se méfier : d’une part il peut craindre que la montre ne soit qu’une imitation, d’autre part il peut craindre que, s’il s’agit vraiment d’une montre de valeur (volée par exemple), le vendeur prenne son argent au moment du règlement et s’enfuie sans donner la montre. Le vendeur n’a pas non plus de raison de faire confiance à l’acheteur. Si ce dernier se montre alléché par ce type de transaction, c’est que son honnêteté n’est pas sans faille. Il peut donc craindre que celui-ci s’enfuie avec la montre sans la payer. Il aurait alors bien peu de recours pour l’y contraindre. Les conditions sont donc telles que l’un et l’autre vont être sur la défensive ; la confiance ne règnera pas. Ce type de situation est connu sous le nom de dilemme du prisonnier. Il ne peut se résoudre en théorie que si la situation se répète indéfiniment et que les partenaires se font confiance. Mais aucun échange ne se répète indéfiniment.
Pourquoi alors, les échanges courants dans le commerce ne sont-ils pas empreints de la même méfiance ? C’est que les commerçants ont pignon sur rue ; ils sont dans le rôle du commerçant honnête et, de leur réputation dépend la pérennité de l’activité dont ils tirent leurs revenus. Cela est connu des acheteurs qui ont alors toutes les raisons d’avoir confiance. Ce ne sont donc pas deux personnes concrètes qui se font confiance mais une personne qui est dans le rôle de l’acheteur et une personne qui est dans le rôle du vendeur et cette interaction là se reproduit bien indéfiniment.
Cela ne signifie pas pour autant que les deux partenaires sont à égalité et qu’ils ont un niveau d’information égal sur les conditions de l’interaction. Akerlof (1970) prend pour exemple le cas de l’achat d’une voiture d’occasion. Il est clair que l’acheteur s’il n’est pas spécialiste ne sera pas en mesure de détecter les vices cachés du véhicule. Il va donc redouter de payer trop cher sa voiture. Dans ces conditions, son intérêt est de ne pas payer cher son véhicule et de se rabattre sur une voiture à bas prix ; au moins s’il est floué, ce ne sera pas de beaucoup. Le vendeur quant à lui, s’il suppose que tous les acheteurs vont tenir ce raisonnement n’a pas intérêt à avoir en stock des véhicules de qualité qu’il devra proposer assez cher et pour lesquels il ne trouvera pas d’acquéreur. Il va donc tendre à ne s’approvisionner que de véhicules bas de gamme. En fait ce n’est pas cela qui se passe. Les vendeurs proposent de bonnes voitures et les clients les achètent. De nombreuses règles ont été édictées afin d’assainir ce type de marché. Des études ont cependant permis de montrer que dans des situations où l’information des partenaires est très déséquilibrée, les acheteurs préfèrent avoir en face d’eux des personnes avec lesquelles ils ont une relation antérieure, non commerciale (familiale, d’amitié, etc.). Il y a en quelque sorte importation d’une forme de confiance non commerciale dans la transaction.
Dans les paragraphes suivants, nous allons explorer différentes situations d’interaction, de façon à repérer des différences fondamentales dans l’origine de la confiance qui fait que l’interaction peut avoir lieu. Cela permettra ensuite de montrer comment les relations, en tant que successions d’interactions, entremêlent des types d’interactions différents et favorisent le renforcement de certains d’entre eux.
2. Les interactions corrélatives
Revenons sur les interactions corrélatives, c’est-à-dire celles dans lesquelles les partenaires ne sont pas des individus semblables mis dans une situation particulière, mais des individus qui se définissent par le rôle qu’ils jouent dans l’interaction.
La tradition sociologique s’est beaucoup centrée sur une catégorie de classes corrélatives, celles qui sont produites par le mécanisme de l’exploitation capitaliste. Le propriétaire des moyens de production ou son représentant est celui qui dispose du pouvoir de décision des conditions dans lesquelles se déroule l’interaction, c’est-à-dire les conditions de l’embauche et plus généralement les conditions de travail. Ce rapport social d’exploitation, pour employer l’expression de la sociologie des classes, a dominé et domine encore pour beaucoup, toute la réflexion sur les interactions.
Marx et Engels, dans le Manifeste du Parti Communiste (1848), l’étendent à toutes les oppressions qui engendrent une lutte pour leur abolition.
L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de luttes de classes. Homme libre et esclave, patricien et plébéien, baron et serf, maître de jurande et compagnon, en un mot oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené une guerre ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée, une guerre qui finissait toujours soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la destruction des deux classes en lutte.
Du point de vue structurel, c’est l’équivalence régulière qui rend le mieux compte de ce rapport là.
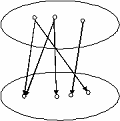
Principe : deux acteurs sont équivalents s’ils sont liés à des acteurs eux-mêmes équivalents (classes corrélatives).
L’équivalence régulière reste une notion à part ; on la maîtrise moins bien que les autres notions. De plus étant donné un réseau, il existe en général plusieurs manières de le classer du point de vue de l’équivalence régulière. Mais mon propos ici n’est pas technique[2], je voudrais mettre l’accent sur les diverses formes des interactions, les modes de contrôle que les partenaires y mettent en œuvre. Or bien des situations d’interaction relèvent de l’équivalence régulière, sans pour autant être des situations d’oppression.
Attardons nous un instant sur un type particulier de classes corrélatives, celles qui sont induites par l’expertise et la compétence. Dans ce cas, nous avons des individus qui sont considérés comme experts dans un domaine et, en face d’eux des individus qui ont recours à leur expertise.
Les interactions «expert-patient»
J’en prends ici principalement deux exemples : les enseignants, d’une part, avec en face d’eux les élèves et surtout les parents d’élèves, et les professions de santé, d’autre part, avec, en face d’elles ceux qu’elles désignent sous le terme générique de patients. Ici les rôles sont figés, ils sont définis par la compétence (il n’est pas imaginable que l’élève prenne la place du professeur ni que le malade prenne celle du médecin).
Du fait de la relation d’expertise, c’est, a priori, celui qui dispose de l’expertise qui définit les conditions de l’interaction, et ce d’autant plus que le rôle de l’expert est institutionnalisé.
Dans le cas de l’éducation, le corps enseignant a de fait le monopole des choix pédagogiques, c’est son domaine et il n’entend pas que les élèves ou les parents d’élèves le lui contestent, même si dans les faits, les associations de parents d’élèves peuvent se montrer influentes.
Dans le domaine médical, le terme de patient est devenu totalement générique et remplace celui de malade. Je ne crois pas que ce soit un hasard ; je pense au contraire que c’est le signe d’une profonde évolution des relations. Ce glissement de vocabulaire accompagne en effet la médicalisation de la société. Ce terme dit bien ce qu’il veut dire, le patient c’est celui qui subit ; ce n’est pas celui qui agit c’est donc celui qui n’a pas le pouvoir de définir les conditions dans lesquelles se déroule l’interaction. Il y a une différence considérable entre parler de malade ou parler de patient. Le malade est qualifié dans son identité propre. Le patient est qualifié par la relation qu’il a avec le corps médical.
Il y a bien d’autres types de situations d’interaction qui sont induites par le fait que l’un des partenaires dépend de l’autre et est apparemment du moins en situation de demandeur. Celui qui donne des conseils et celui qui est conseillé par exemple. Le patient a besoin du médecin, l’élève du professeur. Mais il ne faut pas oublier que le médecin dépend aussi de ses patients et le professeur de ses élèves car sans eux, leur activité n’existerait pas.
Parsons (1951) avait bien noté dans son article sur le « sick role » que l’on pouvait trouver un certain confort à adopter le rôle du malade. Le malade est dégagé d’un certain nombre d’obligations et de responsabilités et une fois qu’il est reconnu comme malade, il peut y trouver un certain confort. De même, la contrepartie du statut de patient, c’est une forme de confort. On se décharge de sa santé sur le corps médical de même qu’on se décharge de l’éducation de ses enfants sur le corps enseignant. Non seulement c’est une commodité mais, dans notre conscience collective, c’est aussi un droit. Pour prendre l’expression de Rawls (1971), ce confort là fait partie des « biens premiers », c’est-à-dire des biens auxquels tout un chacun a droit. De même en ce qui concerne l’éducation, avoir accès à plus d’éducation dispensée par des experts est un progrès en termes d’accomplissement.
J’ai rapproché, d’un point de vue logique, le rapport d’exploitation capitaliste et le rapport de soumission à la compétence dans la même catégorie des classes corrélatives, mais dans l’histoire, le rapport d’exploitation capitaliste a constamment été contesté et suscité la révolte. Il est même le plus souvent évoqué sous l’angle du pouvoir et de la domination.
Le rapport de soumission fondé sur la compétence ne peut pas déboucher sur la révolte puisqu’il apparaît comme naturellement légitime et souhaitable. Notre société développe un certain scientisme qui ne concerne pas seulement les experts mais qui tend à se diffuser dans la société tout entière. Associé à une recherche passive du bien être de la part des patients ou des usagers, il en résulte de plus en plus de propositions de la part des experts et de plus en plus de demande de consommation de la part des usagers. On peut d’ailleurs faire l’hypothèse que cela entraîne dans la représentation de ces derniers un glissement, de l’obligation de moyens faite aux experts à une obligation de résultats. On l’observe de plus en plus souvent dans les discours autour de l’échec scolaire qui mettent en cause le système scolaire ou même les enseignants, pris personnellement à parti, mais aussi dans les rapports entre les médecins et leurs patients qui de plus en plus souvent s’adressent à la justice lorsqu’ils ne sont pas satisfaits des soins qui leur ont été prodigués.
Il faut donc se garder d’associer automatiquement interaction corrélative et domination. D’un point de vue logique, toutes les interactions corrélatives créent des classes, mais seules certaines peuvent être sans équivoque assimilées à une domination. Et surtout, il n’est pas évident que la domination s’exerce toujours de l’expert vers le patient. Du fait de la demande de ce dernier, c’est l’expert qui peut parfois être contraint de se conformer aux désirs de celui qui fait appel à lui, en particulier pour conserver son statut. C’est donc alors ce dernier qui est en position de fixer les conditions dans lesquelles se déroule l’interaction. Le rapport est ambigu. L’exemple du rapport de genre peut aussi alimenter la réflexion sur ce point.
Les rapports de genre
Sous l’expression de rapports de genre, on entend toutes les représentations différentielles des hommes et des femmes et aussi toutes les relations concrètes qui existent au sein des couples. Ils sont omniprésents, au moins autant que les rapports de classe engendrés par le travail. Dans la panoplie des relations, celles qui lient les femmes et les hommes sont évidemment centrales.
La littérature sociologique met en avant le fait que l’organisation sociale, au moins dans les pays occidentaux, favorise les hommes plutôt que les femmes : le droit de vote leur a été accordé récemment au regard de l’histoire (en 1945 en France), à travail égal, elles sont moins bien payées que les hommes, elles ont moins de possibilité d’accéder aux postes de direction dans les entreprises, sans parler des violences des hommes envers les femmes, qui sont fréquentes et en tout cas beaucoup plus fréquentes que les violences des femmes vers les hommes..
Françoise Héritier-Augé trouve l’origine de la domination des femmes par les hommes dans la reproduction : « Ce n’est pas parce qu’elles font les enfants que les femmes sont tenues en dépendance comme un matériau exploitable, ce n’est pas parce qu’elles sont fécondes comme la terre, c’est parce qu’il faut une femme aux hommes pour leur faire des fils » (Héritier-Augé, 2002).
Avec l’exemple des Baruyas (même s’il ne font pas partie des sociétés occidentales) Maurice Godelier (2007) évoque une jalousie plus générale encore, inspirée par la croyance que les femmes sont à l’origine de tout ce qui est important pour les hommes « Ce sont les femmes qui avaient inventé les arcs, les vêtements. Bref les Baruya dans leur vision du monde, reconnaissent à la femme une créativité originaire infiniment plus puissante que celle de l’homme. Mais ils expliquent que cette créativité fut dès l’origine une source permanente de désordre, que les femmes par exemple tournaient les arcs du mauvais côté ou tuaient trop de gibier. Il a donc fallu que les hommes interviennent pour mettre de l’ordre et sauver la société ; en faisant violence aux femmes. […] Nombreuses sont les femmes ridiculisées, insultées, battues. Et disent les Baruya, cette contrainte exercée sur les femmes ne doit jamais prendre fin, car les pouvoirs des femmes n’ont pas disparu après que les hommes s’en sont emparés. A tout moment elles pourraient les reprendre »
Ces anthropologues mettent donc bien l’accent sur un rapport de dépendance entre les hommes et les femmes. Ce sont les femmes qui disposent de l’enfant. Les hommes sont obligés de revendiquer leur descendance et cela induirait d’autres formes de récupération du pouvoir de leur part.
En France, les enquêtes sur le partage du travail domestique ou sur les emplois du temps montrent un partage très inégal des tâches ménagères, qui perdure, malgré une évolution très lente (Dumontier, Guillemot, Meda, 2002 ; Degenne, Lebeaux, Marry, 2002).
Certains sociologues assimilent ce rapport inégalitaire à une exploitation comparable à l’exploitation capitaliste. Pour Gary Becker (1981), le couple, en tant qu’entité productive de biens et de services a intérêt à la spécialisation de ses membres qui les rend plus performants. Comme la femme est de toutes façons plus sollicitée pour la reproduction, le plus efficace est qu’elle se spécialise dans les tâches domestiques. Le partage inégal du travail domestique n’est donc pas le fait d’une domination mais le résultat d’un calcul économique. Pour les conjoints, il n’y a pas d’inégalité, il n’y a qu’une spécialisation. Notons que de ce point de vue, les femmes n’ont aucune raison d’être soumises à une double journée puisque le calcul rationnel les conduit à ne pas travailler hors de chez elles.
François de Singly (2007), dans l’injustice ménagère propose une autre approche. Il constate, lui aussi, que le partage des tâches ménagères entre les conjoints n’évolue guère au cours du temps. Il en propose une explication par la recherche de la compétence par les femmes et la démission des hommes.
En effet, la spécialisation inégale a pour effet de rendre dépendant l’homme qui, tout en bénéficiant des services de sa compagne, perd pour une part une maîtrise de son monde.
La maîtresse de maison dessine l’univers dans lequel elle vit et dans lequel les autres vivent. Il est rare que l’homme dorme dans des draps qu’il a choisis ! Les femmes s’occupent désormais de l’intérieur pour elles-mêmes, pour s’assurer ordre et bien-être et - éventuellement - pour leurs enfants. Mais certainement pas pour l’homme ! Il en tire bénéfice juste parce qu’il partage le même toit. Pour lui, c’est à la fois excluant et confortable - et le réveil est brutal en cas de divorce. Pour elle, c’est une forme de pouvoir secondaire.
Cette explication est du type expert-patient. Elle est peu compatible avec la thèse féministe qui fonde la persistance d’un rapport dissymétrique sur une volonté de domination des hommes sur les femmes et d’exploitation des femmes par les hommes, mais elle rapproche des modes de contrôles des interactions qui appartiennent au domaine privé de ceux que l’on observe dans des contextes très réglementés et institutionnalisés.
Retenons de cette évocation des interactions corrélatives que c’est un type d’interaction assez large, qui se caractérise par la dépendance mutuelle des partenaires, dépendance qui vient de leurs qualités propres. Ils sont différents et c’est cette différence qui crée leur dépendance et induit l’interaction. On peut rapprocher des exemples que nous avons pris (médecin-patient, professeur-élève, hommes-femmes), les producteurs et les consommateurs, les politiciens et leur clientèle, ceux qui donnent des conseils et ceux qui les reçoivent, etc.
3. L’organisation
Une grande partie des interactions ont lieu dans le cadre d’organisations qui prescrivent au moins partiellement les conditions dans lesquelles elles doivent se dérouler.
Ouchi (1980) reprend la thèse de Williamson suivant laquelle une organisation existe parce qu'elle permet de réduire les coûts de transaction entre ses membres, par rapport à ce que ferait un mécanisme de marché. Il fonde son argumentation sur la prise en compte de ce qui rend le mécanisme équitable pour tous, c'est-à-dire qu'il se place du point de vue de la justice, ce qui permet que tout le monde l'accepte (Forsé et Parodi, 2004). C'est ce qui le conduit à donner une place essentielle aux coûts de transaction. Ceux-ci résultent en effet de la nécessité qu'il y a à ce que les partenaires trouvent un accord équitable[3].
Le mécanisme du marché place les individus dans une situation de relative équivalence, le prix étant le moyen qui assure que la transaction est équitable. C'est l'ajustement des prix qui crée la confiance[4]. Le contrôle bureaucratique est d'une autre nature, il est fondé sur la légitimité d'une autorité[5] : « Dans une relation bureaucratique, chaque partie contribue à un ensemble coopératif qui organise les relations en accordant une valeur à chaque contribution et ensuite les compense équitablement. Le sentiment d’équité dans ce cas dépend d’un accord social sur le fait que cette bureaucratie dispose d’une autorité légitime pour produire cette médiation »
Il demeure cependant un problème. Si la transaction n'est semblable à aucune autre, il n'y a pas de marché, pas d'alternative à laquelle elle pourrait se comparer. Le marché ne peut donc pas créer les conditions d'un échange équitable. Si de plus l'échange complexe, suppose l'engagement des parties, le contrat est très difficile à définir dans ses détails. C'est par exemple le cas pour le marché du travail. Prenant l'exemple de la firme japonaise qui fonde son organisation sur une socialisation très intégratrice de ses membres, Ouchi pose alors le principe de la coordination par le clan : "Ainsi, les organisations industrielles peuvent, dans une certaine mesure s’appuyer largement sur la socialisation comme mécanisme principal de médiation et de contrôle et cette forme du clan ( « clan » est pris ici au sens de Durkheim, une association organique qui ressemble à un réseau de parenté mais sans inclure de relations de sang) peut se révéler très efficace pour réguler des transactions entre des individus interdépendants[6] ".
C'est la relation qui devient essentielle. Pour Ouchi, le modèle du clan s'imposerait chaque fois qu'il est impossible de mesurer quelle est la contribution de chaque individu dans la coopération du groupe, même si, suivant le principe mis en avant par Simon, il ne s'attache pas à maximiser son intérêt mais simplement à trouver la situation satisfaisante[7].
Ouchi se réfère à Durkheim dans la division du travail social, mais cette référence est un peu formelle puisqu'il nous donne en fait une définition de son acception du clan : c’est un lieu ou les intérêts individuels et les intérêts collectifs se recouvrent, ce qui rend peu probable les comportements opportunistes et assez facile l’obtention d’un accord équitable.[8]
On retrouve ici ce que Max Weber appelait les formes de domination. (Weber, 1971 [1922]). Le marché n'est pas une forme de domination, C'est un mécanisme d'ajustement. Pour Max Weber, la bureaucratie et la tradition sont des mécanismes de domination. Ouchi ne clarifie pas ce glissement de sens de l'ajustement à l'autorité. Il semble admettre comme naturelle l'idée que l’acceptation des règles bureaucratiques ou de la tradition crée une interaction caractérisée par la domination. Pour lui, il suffit que l’autorité soit légitime. Une interprétation assez naturelle de ce mode de régulation est que les individus s'identifient à l’organisation. Elle devient pour eux une valeur ; ils s'y intègrent et c'est là l'origine de la légitimité de l'autorité.
Retenons comme premier point que la recherche d'une forme d'équité dans tout échange est incontournable et qu'elle impose de trouver une certaine forme institutionnelle.
Retenons en second point l'idée que la réduction des coûts de transaction dans la vie quotidienne est essentielle, même si elle s'opère à travers une logique de rationalité limitée. Ceci nous amène à faire une place particulière à la notion de confiance. Celle-ci peut être induite par la compétence ou le statut de l’interlocuteur, comme nous l’avons vu ci-dessus, elle peut être aussi acquises par une connaissance personnelle, une longue pratique et de multiples expériences partagées, comme nous le verrons plus loin. Mais, lorsque l’organisation est absente, pour réduire les coûts de transaction la confrontation et la négociation peuvent s’imposer spontanément.
4. La confrontation et la négociation
C’est dans la lignée des travaux inspirés par la théorie du choix rationnel, que l’on trouve principalement des réflexions sur la confrontation. Il s’agit du courant de recherche appelé théorie de l’échange.
La théorie de l’échange
Sous ce nom, on range un ensemble de recherches qui, en fait, constituent plus un corps d’hypothèses associées à quelques vérifications empiriques qu’une véritable théorie.
La théorie de l’échange se range dans le corps des travaux sur l’acteur rationnel, mais elle se veut plus large de plusieurs points de vue. Elle ne suppose pas que les échanges aient une contrepartie monétaire. Ils peuvent être de n’importe quelle nature y compris affectifs. Les échanges ne sont pas non plus uniques, sans histoire comme on le suppose des échanges économiques (Cahuc, 1993). Ils sont inscrits dans une relation qui peut être durable. Les échanges ne sont pas isolés, ils se passent dans un réseau d’échanges et le fait qu’un individu qui accède à une ressource à travers un autre puisse ou ne puisse pas trouver des sources alternatives est important. Il y a une équivalence entre la structure des échanges et une structure de pouvoir dans le réseau d’échanges. On trouve donc ici aussi un pont entre les conditions de l’interaction et le pouvoir.
On considère habituellement que les pionniers de la théorie sont Homans, Blau et Emerson, bien que leurs apports soient fort différents.
Homans (1958, 1974) trouve son inspiration dans les expériences sur le comportement des animaux en psychologie expérimentale et il transpose les résultats au comportement humain comme hypothèses. On peut résumer ses principales propositions de la manière suivante :
- Plus importante est la rétribution qu’une personne obtient d’une certaine action, plus cette personne va reproduire cette action.
- Si l’action en question est associée dans le passé à l’apparition d’un certain stimulus, l’apparition du stimulus va favoriser l’apparition de l’action.
- Plus une personne a reçu un certain bien en récompense de son action, moins une nouvelle unité de ce bien aura de valeur pour elle (principe de satiété)
- Si une personne ne reçoit pas une récompense attendue ou reçoit une punition non prévue, elle va adopter un comportement agressif et les résultats de ce comportement prendront de la valeur pour elle. Inversement, si une personne reçoit une récompense imprévue ou ne se voit pas infliger une punition qu’elle attendait, elle adopte un comportement conciliant et les résultats de son action prendront de la valeur pour elle.
Comme on le voit ces principes sont très mécaniques et ne s’inscrivent pas dans un système d’action ni dans un réseau. Mais ces idées sont néanmoins importantes pour la suite, en particulier l’inscription dans le temps des actions et l’inscription de chaque action dans une série d’actions.
Peter M. Blau (1964) va introduire deux idées fondamentales qui existent déjà chez Mauss, celle de la réciprocité de l’échange et celle du pouvoir qui est lié à la non égalité des contributions et des rétributions dans l’échange : « Réciprocité et déséquilibre, tel était le titre que j’avais initialement donné à mon livre. Ces deux termes font référence aux deux principes fondamentaux de la théorie de l’échange social qui sont développés ici, les obligations réciproques qui sont générées et résolues dans les interactions sociales et le déséquilibre des obligations qui engendre les différences de statut.[9] »
Il reviendra à Emerson (1962) de formuler les choses sous la forme d’un corps d’hypothèses cohérent et qui est toujours repris actuellement. Il définit deux notions, celle de dépendance d’un acteur A envers un acteur B et celle de pouvoir de A sur B
La dépendance de A vers B (Dab) est proportionnelle à l’investissement en motivation que l’acteur A fait dans un objectif qu’il ne peut atteindre qu’à travers B et inversement proportionnel à la possibilité pour A d’atteindre ce but sans passer par B.
Le pouvoir de A sur B (Pab) est la partie de la résistance de B qui peut être vaincue par A.
Emerson pose l’égalité : Pab = Dba, Pba = Dab
La relation entre A et B est équilibrée si Pab= Pba, elle est déséquilibrée dans le cas contraire.
Le coût pour mettre en œuvre un échange est égal à la résistance qui doit être vaincue pour que l’échange se produise.
Emerson s’intéresse alors aux manières de réduire le degré de déséquilibre. Il s’agit de réduire l’écart entre le pouvoir de A sur B et le pouvoir de B sur A. Cette réduction sera obtenue si :
B réduit son intérêt pour les objectifs que A contrôle. C’est un retrait. Il peut aller jusqu’à ce que B se retire de l’échange que contrôle B.
B cherche des partenaires autres que A pour atteindre ses objectifs. Cela ne veut pas dire qu’il se retire de l’échange mais que la donne est transformée par la présence des autres partenaires.
A augmente son intérêt pour les objectifs contrôlés par B, ainsi le pouvoir de B sur A augmente.
B construit une coalition avec un autre individu C qui est lui aussi intéressé par l’objectif que A contrôle.
On passe d’hypothèses sur l’échange entre deux partenaires à des hypothèses concernant plus de deux partenaires. Il était donc naturel que l’on en vint à s’intéresser au réseau et à explorer comment des échanges peuvent naître au sein d’un réseau en fonction de la position des différentes personnes dans ce réseau, de leur centralité par exemple ou de leur centralité d’intermédiarité. (Cook et al., 1983, Cook, Yamagishi, 1992, Cook, Whitmeyer, 1992, Kollock, 1994). On retrouve ici des intuitions déjà présentes chez Bavelas.
Cook, Emerson, Gillmore et Yamagishi (1983) vont poser une hypothèse supplémentaire fondée sur la triade : Si deux échanges AB et AC sont mutuellement dépendants, la connexion entre B et C est positive si le premier échange est contingent au second et négative dans le cas inverse. Autrement dit si B et C sont des sources alternatives pour A, le lien entre B et C est négatif. Le réseau connecté négativement offre donc une possibilité d’extension de la notion de distribution du pouvoir dans un réseau d’échange.
Yamagishi, Gillmore et Cook (1988) testent expérimentalement, ainsi qu’au moyen de simulations, les hypothèses sur l’influence de la structure du réseau sur les échanges. Ils posent que la localisation du pouvoir dans un réseau d’échanges dépend de la nature des connections – positives ou négatives - et de la pénurie des ressources. Ils concluent que si le réseau n’a que des liens positifs, la rareté des ressources détermine seule la localisation du pouvoir en fonction des hypothèses de la théorie de l’échange. Si les connections sont négatives, la possibilité d’accéder aux ressources à travers des partenaires alternatifs détermine la localisation des lieux de pouvoir. Si le réseau est mixte et contient à la fois des relations positives et des relations négatives, la distribution du pouvoir dépend à la fois de la position dans le réseau et du contrôle des ressources.
Molm (1997) propose un ouvrage assez synthétique fondé sur des vérifications expérimentales menées auprès d’étudiants. Elle reprend une bonne partie des hypothèses posées antérieurement, ce qui fait de son ouvrage une synthèse intéressante. Il convient d’abord de fixer le vocabulaire :
Acteurs – Les acteurs se comportent de manière à accroître les résultats qu’ils valorisent positivement et à diminuer ceux qu’ils valorisent négativement.
Ressources – Chaque classe de résultats valorisés obéit au principe de satiété. En termes économiques cela correspond à la diminution de l’utilité marginale.
Structure d’échange – Les relations d’échange se développent dans des structures de dépendance mutuelle.
Processus d’échange ; il a deux dimensions :
Les transactions d’échange : ce sont les bénéfices obtenus d’autres acteurs et ils sont contingents aux bénéfices donnés en échange.
Les relations d’échange : les acteurs sont engagés dans des échanges récursifs et indépendants avec des partenaires donnés, au cours du temps.
Le pouvoir de A sur B est égal à la dépendance de B par rapport à A.
La dépendance de B par rapport à A croît avec la valeur de ce que A apporte à B et décroît en fonction de l’existence de sources alternatives que B peut mobiliser pour accéder aux mêmes ressources.
Les acteurs engagent des échanges en récompensant ceux dont ils dépendent.
Les acteurs augmentent les échanges qui sont plus rémunérateurs pour eux ou moins coûteux et diminuent ceux qui sont moins rémunérateurs ou plus coûteux et ils cherchent ailleurs des sources alternatives quand la rémunération décroît ou que les coûts augmentent. Les stratégies sont dynamiques et adaptatives. Elles incluent les gains et les coûts.
Conséquences :
Les engagements d’échange de A vers B augmentent avec la dépendance de A par rapport à B et donc le pouvoir de B sur A.
La fréquence moyenne des échanges dans une relation augmente avec le pouvoir moyen et la dépendance
L’asymétrie de l’échange dans une relation croît en même temps que le déséquilibre du pouvoir, en faveur du plus puissant.
Une autre série d’hypothèses porte sur les résultats. Le point de référence pour évaluer un échange est le statu quo.
Les résultats sont considérés comme des gains s’ils améliorent le statut de l’acteur et comme des pertes s’ils le détériorent.
La valeur marginale des gains et des pertes décroît avec leur distance au point de référence.
La valeur subjective négative d’une perte est plus grande que la valeur subjective positive d’un gain équivalent. Conséquence, le biais de statu quo : quand le gain potentiel à l’entrée dans un échange n’est pas supérieur aux pertes envisageables, il n’y a pas d’engagement. Les acteurs préfèrent le statu quo. Aussi longtemps que les chances de gain sont équivalentes aux pertes envisageables, l’aversion pour la perte fait que l’acteur préfère ne rien faire.
D’autres propositions ont trait au sentiment de justice et au principe de réciprocité dans l’échange :
- Dans les relations équilibrées d’échange direct, le standard d’échange est la réciprocité. Si le déséquilibre en pouvoir est important, les attentes attachées à une position de pouvoir déplacent ce standard dans une position qui est conforme au pouvoir relatif des acteurs (Degenne, Forsé, 2004).
- Quand les résultats de l’échange s’éloignent du standard, celui qui a le plus de punitions et le moins de bénéfice va éprouver un sentiment d’injustice ; cet acteur va réagir de manière à diminuer le sentiment d’injustice, en augmentant les punitions et en diminuant la rétribution de son partenaire.
L’injustice perçue est plus grande si elle résulte de la contrainte plutôt que de la rétribution.
Dans la théorie de l’échange, les interactions ne sont pas médiatisées par le contexte social. Celui-ci se réduit à un réseau ; pas de rôles, pas de règles ni de conventions. Or, si les propositions développées ci-dessus semblent raisonnables, elles ne peuvent trouver leur efficacité que médiatisées par la culture du lieu où se déroulent les interactions et compte tenu des circonstances et du contexte.
5. L’interconnaissance et les interactions autonomes
Dans ce cas, la question du contrôle de l’interaction ne se pose pratiquement pas. Non pas qu’une organisation en règle les modalités mais parce que les partenaires se connaissent suffisamment pour qu’ils estiment qu’il n’existe pratiquement aucune incertitude sur le comportement de l’autre.
Les faits nous montrent, en effet une autre forme de mécanisme producteur de confiance qui est l'expertise que chacun a sur l'autre. Ce que je sais sur quelqu'un est la manière la plus simple et la plus spontanée de réduire l'incertitude sur son comportement à venir. Cette connaissance peut être directe, c'est-à-dire qu'elle est le produit d'expériences communes, ou elle peut être indirecte, c'est-à-dire fournie par d'autres personnes qui connaissent le partenaire. De nombreux employeurs soumettent les personnes qu'ils envisagent d'embaucher à une période d'essai. Même un système bureaucratique comme celui de la fonction publique en France prévoit une période de stage. De même, la collecte d'information auprès des employeurs précédents est une pratique courante. Du point de vue de l'employeur, l'acquisition d'une connaissance sur le comportement du salarié est donc un moyen très général de contrôle. Certaines entreprise ou organismes intermédiaires pratiquent d'ailleurs de nombreux tests de connaissance ou tests psychologiques, graphologiques etc. qui sont supposés réduire l'incertitude sur le comportement du salarié potentiel. L'information recueillie par le salarié sur les conditions de travail et de rémunération dans l'entreprise est évidemment tout aussi importante.
Mais plus que tout cela, c'est la connaissance directe par l'expérience du travail en commun au quotidien qui constitue un mécanisme de contrôle essentiel et universellement répandu.
Ceci a une conséquence immédiate et souvent méconnue par les sociologues friands d'une vision évolutionniste de la société : il apparaît sans cesse de nouvelles formes d'organisation et de contrôle qui sont des actualisations et des combinaisons de mécanismes de l'un des types repérés ci-dessus.
Dans le cas général, ces connaissances de l’un sur l’autre supposent une histoire commune, des expériences partagées. Plus on se côtoie, plus on acquiert de connaissances sur l’autre, mais plus aussi, il se crée une culture commune, des règles d’interaction, qui rendent les négociations inutiles.
Claire Bidart (1997) considère que c’est la multiplicité des contextes qui crée l’autonomie d’une relation.
Mais je ne veux me centrer à ce stade du raisonnement que sur les interactions. Les relations viendront après, même si c’est à cause de l’existence d’une relation, d’une histoire commune que l’interaction peut être qualifiée d’autonome.
Une interaction est autonome lorsque elle est fondée sur l’interconnaissance et qu’il existe entre les partenaires ce que j’ai appelé une culture commune spécifique de ce couple de personnes. C’est l’existence de cette culture propre qui va caractériser ce type d’interactions et le distinguer des trois autres types que nous avons repérés.
6. Quatre types d’interactions
Interactions autonomes, confrontation, interactions définies par une organisation et interactions corrélatives sont en effet les quatre types que nous avons repérés. Ce sont évidemment de grandes catégories
- Les interactions corrélatives sont induites par le fait que les partenaires ont des qualités différentes qui rendent nécessaire leur interaction. La forme de l’interaction, sa régulation en découle généralement.
- Une organisation définit quelles sont les interactions qui nécessairement doivent exister en son sein et quelles formes elles prennent.
- On est dans le cadre d’une confrontation ou d’une négociation si l’interaction est première et que les partenaires y définissent eux-mêmes les règles de leur échange.
- L’interaction autonome ne dépend pas du contexte dans lequel elle s’exerce, ni des qualités des partenaires, mais elle obéit à des règles qui résultent de l’histoire de la relation et ne se définissent pas dans cette interaction. Elle suppose une interconnaissance des partenaires.
Bien entendu ces critères sont abstraits ; ils servent à définir des formes d’interaction idealtypiques. Les interactions concrètes peuvent combiner plusieurs de ces caractéristiques et plus encore les relations qui sont des histoires. Pourtant, lorsque les interactions, ne s’autonomisent pas dans une relation suivie, il y a de bonnes chances pour qu’elles prennent une des trois formes qui ne sont pas celle de l’interaction autonome (confrontation-négociation, interaction corrélative ou interaction définie par une organisation) et l’on ne glisse pas facilement vers une relation où les interactions sont autonomes. Même s’il y a de nombreux glissements dans les interactions concrètes, il reste que le médecin et son patient, à supposer qu’ils nouent une relation personnelle, retrouveront leurs rôles respectifs lors d’une consultation. De même l’élève et le professeur, s’il se tisse un lien particulier entre eux ne seront pas des copains dans le contexte du lycée.
Notons par exemple que dans son travail sur un important cabinet d’avocats aux Etats-Unis, Emmanuel Lazega (1992, 2001) a construit son enquête sur trois types d’interactions : la coopération, le conseil, et l’amitié. On peut penser que la coopération est induite par l’activité même de l’organisation, mais elle suppose cependant des choix préférentiels, le conseil est bien lié aux compétences des conseilleurs, même si cette qualité n’est pas formellement instituée, l’amitié se retrouve dans tous les contextes où des personnes se côtoient et vivent ensemble durablement, mais elle interfère avec toutes les autres formes d’interactions.
De ces exemples, il semble que l’on peut retirer plusieurs enseignements.
Tout d’abord, il n’y a aucune raison de faire a priori l’hypothèse qu’une interaction est symétrique. On peut considérer que pour l’analyse, cela n’a pas d’importance, mais encore faut-il que cela résulte d’une décision argumentée de l’analyste.
Ensuite il n’y a aucune raison de passer automatiquement du constat d’un déséquilibre dans une interaction à une interprétation en termes de domination. C’est sans doute un glissement facile lorsqu’on regarde les choses ponctuellement et qu’on ne s’intéresse pas aux processus, mais dès que l’on observe les conditions dans lesquelles se déroulent les interactions au sein de relations qui perdurent, les déséquilibres peuvent s’interpréter autrement qu’en termes de domination, par exemple comme facteurs de dynamisme dans une relation qui ne cherche pas nécessairement à évoluer vers l’équilibre. Il y a donc constamment reconstruction du réseau des interactions.
Passons alors aux relations.
7. Relations
On peut, envisager des probabilités de passage entre les différents types d’interactions repérés ci-dessus. Cela reste une sorte d’exercice d’école, ne serait-ce que parce qu’on néglige alors les effets du contexte. Il me semble cependant qu’on peut se livrer à cet exercice puisqu’on y raisonne en termes de probabilités et que les valeurs proposées ici ne sont qu’indicatives.
Les relations sont des successions d’interactions. Les partenaires se revoient, se reconnaissent. Ils ont à l’esprit les expériences de leurs interactions précédentes et ceci constitue une sorte de capital commun qui va influencer l’interaction à venir. C’est ce qui fait que très vite, dès l’instant où deux personnes se revoient, leur interaction cesse d’être complètement « pure » du point de vue du type et comporte une certaine part d’autonomie, si faible soit-elle.
La multiplexité, c’est-à-dire la variété des contextes et des circonstances dans lesquels les partenaires ont eu des échanges, la diversité de leurs expériences partagées, tout cela intervient. Mais même lorsque le contexte est unique, une certaine forme de glissement vers l’autonomie résulte automatiquement de la répétition des interactions. C’est sans doute de là que vient le paradoxe apparent que j’ai évoqué au début, le fait que l’on considère spontanément une relation comme réciproque et autonome ce qui autorise à l’analyser dans le modèle des graphes non orientés.
Il faut faire une place importante à la routine. Les habitudes se prennent facilement et c’est même une des manières privilégiées d’éviter d’avoir recours à la négociation. Nous avons évoqué le cas du couple où chacun s’installe dans un rôle. La routine y est pour beaucoup car la négociation des petites choses de la vie est coûteuse en temps et en sérénité des rapports. Il est souvent plus simple de répéter ce que l’on a fait. Il en va de même dans les organisations car même si des règles formelles existent, il peut être plus avantageux de reconnaître certaines habitudes prises par les personnes dans leurs interactions que de leur imposer de rentrer dans un cadre prévu.
Bien entendu, des interactions avec des personnes nouvelles se produisent sans arrêt, de nouvelles relations s’ébauchent, d’autres disparaissent, provisoirement ou définitivement. Le hasard joue un grand rôle et certains phénomènes imprévisibles peuvent créer des bouleversements définitifs (Grossetti, 2004). Quand nous parlons de relations, il s’agit de séquences relationnelles d’une durée variable. L’apparition de relations nouvelles n’est pas traitée ci-dessous, ni la disparition des relations. Pour le faire, il faudrait introduire un état d’absence d’interaction dans le processus ci-dessous.
Représentons nous donc les relations comme des suites d’interactions dont chacune appartient à l’un des quatre types repérés plus haut et essayons d’apprécier l’ordre de grandeur de la probabilité pour que entre deux personnes données, une interaction d’un certain type succède à une interaction d’un autre type.
Si l’interaction est une confrontation, il y a peu d’expérience commune ou elle ne joue pas, il n’y a pas de confiance, on peut donc penser que l’interaction suivante sera assez souvent du même type. Pour fixer les idées disons dans 7 cas sur dix. Mais il est des cas où les personnes appartiennent à la même organisation, dans ce cas les règles de cette organisation peuvent reprendre leurs droits. Supposons que cela se passe dans deux cas sur 10. J’estime qu’il doit être exceptionnel qu’une confrontation débouche sur une relation corrélative car si les partenaires ne sont pas dans une relation de confiance, il est probable qu’ils chercheront une alternative comme le prévoit la théorie de l’échange. Fixons cette probabilité à 0.
Dans quelques cas la confrontation sera suivie d’une interaction autonome, soit que la confrontation soit occasionnelle, soit qu’elle débouche sur une routine ou un accord durable ; disons dans un cas sur 10.
Si l’interaction est induite par des règles organisationnelles, celles-ci vont s’imposer lors des interactions suivantes. Il sera donc rare qu’une interaction de ce type soit suivie d’une interaction d’un autre type. Disons que dans 70% des cas elle sera suivie d’une interaction semblable. Il doit être exceptionnel que l’interaction suivante soit une confrontation puisque l’organisation existe précisément pour l’éviter et réduire les coûts de transaction ; disons dans 5% des cas. Il est sans doute assez rare aussi que l’interaction suivante soit corrélative. Néanmoins, les organisations ne sont pas toutes rigides et le recours au conseil entre les employés est assez fréquent (Lazega, 1992, 1994) ; disons dans 10% des cas. Il reste que la relation va s’autonomiser dans 15% des cas, c’est-à-dire que nous prévoyons que l’interaction suivante sera de type autonome dans 15% des cas.
Envisageons alors une relation corrélative. Elle est définie par les qualités des personnes qui sont très stables et renvoient à des rôles sociaux. Si les deux personnes se sont rencontrées c’est parce qu’il était nécessaires pour elles de jouer leur rôle. Bien sûr, il peut exister des glissements. Fixons à 5% la probabilité pour que l’interaction suivante soit une confrontation ou une interaction définie par une organisation ou une interaction autonome. Cela signifie que dans 85% des cas une interaction corrélative sera suivie d’une interaction corrélative.
Enfin, si une interaction est autonome, c’est que les partenaires se connaissent bien, qu’ils ont une culture commune qui leur est propre, des habitudes d’échange. Il peut arriver un désaccord qui prendra la forme d’une confrontation. Il peut aussi arriver que les règles d’une organisation s’imposent mais on peut penser que ceci sera assez rare. On ne peut pas exclure le cas où une interaction autonome est suivie d’une interaction corrélative, une demande de conseil par exemple.[10] C’est même l’hypothèse que font certains sociologues de l’innovation (Chiffoleau, 2005). Posons que dans 5% des cas, on observera le passage d’une interaction autonome à une interaction corrélative. Posons que dans 5% des cas une interaction autonome pourra être suivie d’une confrontation, dans 5% des cas d’une interaction d’organisation et dans 85% des cas d’une autre interaction autonome.
On obtient ainsi une matrice qui indique avec quelle probabilité une interaction d’un certain type peut être suivie d’une interaction d’un autre type. C’est une matrice stochastique, car la somme des éléments de chaque ligne vaut 1.
Dans ce modèle la probabilité pour qu’une interaction d’un certain type apparaisse ne dépend que du type de l’interaction précédente et la matrice est supposée invariable au cours du temps. C’est ce qu’on appelle un processus de Markov. Les propriétés en sont bien connues.
|
|
Type d’interaction à l’instant t |
||||
|
Confrontation |
Organisation |
Corrélative |
Autonome |
||
|
Type d’interaction à l’instant t-1 |
Confrontation |
0,7 |
0,2 |
0 |
0,1 |
|
Organisation |
0,05 |
0,7 |
0,1 |
0,15 |
|
|
Corrélative |
0,05 |
0,05 |
0,85 |
0,05 |
|
|
Autonome |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,85 |
|
On obtient en particulier une distribution des types d’interaction dans un régime de croisière, c’est-à-dire après un temps de fonctionnement assez long, en élevant cette matrice à une puissance assez grande. Les lignes se stabilisent alors et reflètent cette distribution.
Dans notre cas, la distribution devient :
|
Confrontation |
Organisation |
Corrélative |
Autonome |
|
0,14 |
0,20 |
0,27 |
0,39 |
Ainsi dans la moyenne des relations durables entre deux personnes, on pourrait s’attendre à trouver une confrontation dans 14 % des cas (environ une fois sur 7), une relation définie par des règles organisationnelles dans 20% des cas (moins d’une fois sur 5), de 27% pour les interactions corrélatives, et une interaction autonome quatre fois sur 10.
Quelle est l’utilité de ce type de simulation ? On peut en effet me dire que j’ai choisi les chiffres de façon à obtenir ce type de résultat. De fait, tant qu’ils ne résulteront pas d’estimations faites à partir d’observations de terrain, ils garderont leur caractère arbitraire. Mais l’intérêt de la simulation est aussi de faire varier un peu les probabilités et de confronter le résultat obtenu aux proportions que l’on peut observer dans la réalité. Or dire que dans une relation, une interaction est de type autonome, c’est-à-dire qui se déroule suivant les habitudes ordinaires d’échange des partenaires, quatre fois sur dix n’est pas choquant. Trouver 27% pour les relations corrélatives peut sembler beaucoup mais il faut tenir compte du fait qu’on y range toutes les interactions de rôle et les interactions de conseil au sein de l’organisation par exemple. D’ailleurs il faut bien noter que les proportions que l’on pourra observer dépendront fortement du milieu observé. La matrice ne sera pas la même pour des interactions qui vont se passer dans le contexte familial ou dans celui de l’entreprise par exemple.
On peut aussi, facilement tester tout une série d’hypothèses sur la matricede passage pour voir les résultats et apprécier l’importance des changements et la sensibilité de la distribution à ces variations. On constaterait alors que le résultat est très sensible aux variations qui consistent à diminuer les probabilités diagonales qui représentent la reproduction de l’interaction précédente et à augmenter les probabilités de passage vers un autre type d’interaction. Ceci nous renvoie à la remarque sur l’importance de la routine dans les processus interactionnistes.
Conclusion : les relations au delà des interactions autonomes
Si l’on observe une relation qui a une histoire assez longue, il y a bien des chances pour que cela soit sous la forme d’une interaction autonome, puisque ce sont les plus fréquentes. Cela peut constituer le point de départ d’une réflexion sur les raisons qui font qu’on est assez spontanément incité à associer le terme de relation avec des échanges positifs et équilibrés. De ce point de vue, la théorie de l’échange représente déjà une avancée, même si elle ne tient pas compte des contraintes organisationnelles ni des interactions corrélatives c’est-à-dire des rôles sociaux.
Nous sommes encore loin de l’observation des relations dans la durée, de la prise en compte des formes variées des interactions, qui permettrait de traiter ces relations dans leur complexité. Mais j’espère avoir montré que cela pourrait être intéressant, même si je suis conscient qu’il serait bien difficile de faire une enquête qui permettrait de remplir avec des estimations sérieuses, la matrice des probabilités de passage que j’ai remplie a priori.
Rien ne justifie à mes yeux qu’on exclue a priori du champ des relations, les interactions de rôles ou les interactions qui se déroulent dans les organisations, par exemple au travail. Il n’y a pas de frontière entre le domaine du travail qui est dominé par l’organisation, celui des échanges avec les institutions qui sont dominés par les rôles, celui des amitiés ou encore le couple. Les glissements sont constants. Il en résulte des relations riches et variées. Je plaiderai pour qu’une sociologie qui se veut interactionniste n’hésite pas à s’attaquer à cette complexité.
Références
Akerlof G., (1970). «The Market for Lemons. Qualitative Uncertainty and the Market Mechanism », Quarterly Journal of Economics, 84, 488-500.
Becker G., (1981). A Treatise on the Family. Cambridge: Harvard University Press.
Bidart C., (1997). L’amitié un lien social. París, La Découverte
Blau P., (1964). Exchange and Power in Social Life. New York: Wiley.
Cahuc P., (1993). La nouvelle micro-économie. París : La Découverte.
Chiffoleau Y., (2005). Learning about innovation through networks: the development of environment- friendly viticulture, Technovation, 25, 1193-1204.
Coleman J., (1990). Foundations of Social Theory. Cambridge: the Belknap Press of Harvard University Press.
Cook K. S., & Yamagishi T., (1992). «Power in Exchange Networks: a Power-Dependence Formulation », Social Networks, 14, 3-4, 245-265.
Cook K.S., Emerson R.M., Gillmore M.R., Yamagishi T., (1983). The distribution of power in exchange networks: Theory and experimental results, The American Journal of Sociology, 89(2). 275-305.
Cook, K.S., Whitmeyer J.M., (1992). Two approaches to social structure: Exchange theory and network analysis, Annual Review of Sociology, 18, 109-127
Degenne A., Forsé M., (2004). Les réseaux sociaux, une analyse structurale en sociologie. París, Armand Colin, 284 p.
Degenne A., Lebeaux, M.-O., Marry C., (2002). Les usages du temps : cumul des activités et rythmes de vie, Economie et statistique, 352-353, 81-99.
Dumontier F., Guillemot D., Méda D., (2002). L’évolution des temps sociaux à travers les enquêtes Emploi du temps, Economie et statistique, 352-353, 2-13.
Doreian, P., Batagelj, V., Ferligoj, A., (2005). Generalized Blockmodeling. Cambridge: Cambridge University Press.
Emerson R. M., (1962). Power-dependence relations, American Sociological Review, 27, 31-40.
Emerson R.M., (1976). Social Exchange Theory, Annual Review of Sociology, 3,335-362.
Forsé, M., Parodi M., (2004). La priorité du juste. París, PUF.
Godelier, M. (2007). Au fondement des sociétés humaines. Ce que nous apprend l’anthropologie. París, Albin Michel
Grossetti M., (2004). Sociologie de l’imprévisible. París, PUF
Héritier Augé F., (2002). Masculin féminin II, Dissoudre la hiérarchie. París, Odile Jacob
Homans G. C., (1958). « Social Behavior as Exchange», American Journal of Sociology, 62, 597-606.
Homans G.C., (1974). Elementary Forms of Social Behavior. New York: Harcourt Brace Yanovitch.
Kollock P., (1994). The emergence of exchange structures: An experimental study of uncertainty, commitment and trust, The American Journal of Sociology, 100(2). 313-345.
Lazega E., (1992). Une analyse de réseaux : les avocats d'affaire, Revue Française de Sociologie, XXXIII, 4, 559-589.
Lazega E., (1994). Analyse de réseaux et sociologie des organisations, Revue Française de Sociologie, XXXV, 2, 293-320
Lazega, E. (2001). The Collegial Phenomenon:The Social Mechanisms of Cooperation Among Peers in a Corporate Law Partnership. Oxford, Oxford University Press.
Marx K., Engels F., (1848). Manifeste du parti communiste. Librio.
Molm L. D., (1997). Coercive Power in Social Exchange. Cambridge, Cambridge University Press.
Ossowski S., (1971). La structure de classe dans la conscience sociale. Anthropos : París.
Ouchi, W.G., (1980). Markets, Bureaucracies and Clans, Administrative Science Quarterly, 25(1). 129-141.
Parlebas P., (1986). Eléments de sociologie du sport, París, PUF.
Parsons T., (1951). Illness and the Role of the Physician: A Sociological Perspective, The American Journal of Orthopsychiatry, 21, 452-460.
Rawls J., (1971). A Theory of Justice. Cambridge, Harvard University Press.
Saussure F. de, (1969) [1915], Cours de linguistique générale. París : Payot.
Singly (de) F. (dir) (2007). L’injustice ménagère. París, Armand Colin
Weber M., (1971). Economie et société. París : Plon, (traducción de M.Weber, 1922, Wirtschaft und Gesellschaft).
Yamagishi T., Gillmore M.R., Cook K.S., (1988). Network connections and the distribution of power in exchange networks, The American Journal of Sociology, 93(4). 833-851.